La Commune de Paris Suite et fin de la Révolution Ou prémices d’une véritable République sociale ?
En cette année 2021 nous commémorons les 150 ans de la Commune de Paris. C’est un épisode tout à fait singulier de l’histoire de France qui intervient à l’issue de la défaite de la France de Napoléon III contre les Prussiens à Sedan. La Commune a inspiré de nombreux mouvements révolutionnaires, en France et à l’étranger (révolutions russe, espagnole et en Amérique du Sud). Tel un atelier préparatoire, elle a expérimenté différents modes de gouvernance, dans le travail et dans la politique, qui demeurent dans la conscience des Français et restent à accomplir. On peut se demander si la Commune est le dernier grand épisode révolutionnaire français (après celles de 1789, 1830 et 1848) ou en même temps, les prémices d’une véritable République sociale qui reste à construire ?
Le gouvernement de défense nationale : Paris contre Versailles et le pays
Dès l’annonce de la défaite de Sedan et de l’arrestation de Napoléon III, l’opposition parlementaire républicaine, conduite par Léon Gambetta, avait mis en place un gouvernement provisoire, dit de défense nationale, et proclamé la République le 4 septembre 1870, dans le haut lieu consacré de la capitale : au balcon de l’hôtel de ville. Voici la présentation et l’analyse de l’évènement par Karl Marx[1], qui permet de comprendre le futur soulèvement de la Commune :
Le 4 septembre 1870, quand les ouvriers de Paris proclamèrent la république, qui fut presque instantanément acclamée d’un bout à l’autre de la France, sans une seule voix discordante, une cabale d’avocats en quête de places, avec Thiers pour homme d’État et Trochu pour général, s’empara de l’Hôtel de Ville. Ces gens étaient alors imbus d’une foi si fanatique dans la mission dévolue à Paris de représenter la France à toutes les époques de crise historique que, pour légitimer leurs titres usurpés au gouvernement de la France, ils crurent suffisant de produire leurs mandats périmés de représentants de Paris. […] Toutefois, les véritables dirigeants de la classe ouvrière étant encore bouclés dans les prisons bonapartistes et les Prussiens déjà en marche sur la ville, Paris, pris à l’improviste, toléra cette prise du pouvoir, à la condition expresse qu’il ne serait exercé qu’aux seules fins de défense nationale. Cependant, comment défendre Paris sans armer sa classe ouvrière, sans l’organiser en une force effective et instruire ses rangs par la guerre elle-même ? Mais Paris armé, c’était la révolution armée. Une victoire de Paris sur l’agresseur prussien aurait été une victoire de l’ouvrier français sur le capitaliste français et ses parasites d’État. Dans ce conflit entre le devoir national et l’intérêt de classe, le gouvernement de la Défense nationale n’hésita pas un instant : il se transforma en un gouvernement de la Défection nationale.
Plusieurs villes de province, Lyon en tête, avaient déjà initié la démarche. Ce gouvernement compte à sa tête le général Trochu, Gambetta à l’intérieur et Jules Favre aux Affaires étrangères. Après la capitulation de Paris, le 28 janvier, le gouvernement négocie une trêve pour organiser des élections ; opposé à la trêve, Gambetta démissionne. Les élections ont lieu le 8 février 1871, sans qu’aucune force en présence n’ait eu le temps de faire campagne, sauf à Paris. Le scrutin reprend la forme de la Seconde République (scrutin de liste, départemental et majoritaire), en opposition au scrutin uninominal à deux tours qui était la règle sous le Second Empire. Les élections ne portent pas sur le choix du régime, mais sur le thème de la guerre à arrêter ou à poursuivre, car la moitié des départements sont occupés, et plus de 400 000 Français sont prisonniers. Les conservateurs, tous camps confondus (de la bourgeoisie libérale aux monarchistes), se résignent à la paix, alors que les Républicains sont divisés : Gambetta et les plus radicaux souhaitent poursuivre la guerre, de même que les Bonapartistes qui aspirent au retour de l’impératrice et de son fils, partis en exil au lendemain de la proclamation de la République. Finalement, l’Assemblée est majoritairement monarchiste : sur 675 élus, environ 400 monarchistes (légitimistes et orléanistes), et 250 républicains avec une minorité de socialistes, et quelques bonapartistes. Les départements envahis ont voté majoritairement pour les républicains et la poursuite de la guerre, de même que le Midi et Paris. Le reste des Français préférant la paix a voté pour les candidats qui la prônaient, sans être pour autant monarchistes et antirépublicains. Cette majorité nomme un chef du pouvoir exécutif, et remet en selle l’éternel revenant du XIXe siècle, l’homme qui a su traverser tous les régimes et s’y adapter en reniant le lendemain ses engagements de la veille, celui qui « dans un siècle où la Révolution a usé tous les hommes a fini par user la Révolution[2] »: Adolphe Thiers, dont Marx dresse ce portrait au vitriol : « Thiers, ce nabot monstrueux, a tenu sous le charme la bourgeoisie française pendant plus d’un demi-siècle, parce qu’il est l’expression intellectuelle la plus achevée de sa propre corruption de classe[3]. »
Thiers constitue un gouvernement avec des ministres du centre droit et du centre gauche. L’objectif de ce gouvernement est de parer aux urgences, avant de considérer les questions institutionnelles (quelle constitution pour cette nouvelle République ?). Il s’agit de faire la paix avec l’Allemagne, et de relancer le pays après ce traumatisme. Les conditions de paix imposées par Bismarck sont exorbitantes : une indemnité de 5 milliards, et la cession des territoires de l’Alsace (sauf Belfort qui avait été défendu avec acharnement par Denfert-Rochereau), la Moselle, une partie de la Meurthe et des Vosges, que l’on nommera par facilité : l’Alsace-Lorraine, et, humiliation suprême pour les Parisiens, un défilé des troupes allemandes sur les Champs Elysées. Le projet de traité est ratifié à l’Assemblée, lors d’une séance dramatique le 1er mars 1871. La grande majorité des députés l’adoptent contre une centaine seulement qui la rejettent : parmi eux tous les députés de Paris : Louis Blanc, Victor Hugo, Georges Clémenceau. Les députés d’Alsace et de Lorraine démissionnent ainsi que de nombreux républicains. L’extrême gauche socialiste et internationaliste désavoue l’Assemblée et lui dénie toute légitimité. Le traité sera signé à Francfort le 10 mai 1871 (en pleine Commune de Paris)[4].
Dans ce contexte, dès le 10 mars le gouvernement de Thiers prend des mesures très provocatrices à l’égard des Parisiens dont il se méfie ( à se demander si cette provocation n’a pas été soigneusement calculée pour circonscrire les opposants de la capitale) : il nomme trois bonapartistes préfet de police (celui-ci interdit aussitôt les journaux d’extrême gauche dont Le cri du peuple de Jules Vallès), gouverneur de Paris et commandant de la garde nationale ; il fait voter par l’Assemblée la fin du moratoire des loyers et des effets de commerce : plus de 150 000 Parisiens sont menacés d’expulsion, de faillite et de poursuites judiciaires. Il est décidé de déménager l’Assemblée et le gouvernement à Versailles à partir du 20. Enfin, ordre est donné de confisquer les canons encore détenus par les Parisiens. L’exaspération des Parisiens est à son comble : ils ont soutenu la proclamation de la république, ils ont courageusement défendu Paris contre les armées étrangères, souscrit pour payer les canons, subi les privations et la faim, leurs représentants ont voté massivement contre la capitulation, et ils considèrent que cette Assemblée de « ruraux » arriérés et conservateurs ne les représente pas. La tentative de saisie des canons par l’armée le 18 mars à Montmartre soulève tout Paris. Thiers s’attendait à une insurrection, et peut-être même l’a-t-il sciemment provoquée, car il fait arrêter le même jour Auguste Blanqui qui, malade, se reposait chez des amis dans le Lot. Ce révolutionnaire, ancien carbonaro, ayant participé à tous les combats du siècle pour la liberté et la République, et de ce fait éternel détenu, était le chef naturel de l’insurrection parisienne, et son absence a tragiquement fait défaut à la Commune[5].
La Commune de Paris[6]
Qui sont ces insurgés parisiens ? Ils sont réellement le peuple de Paris : les ouvriers du bâtiment, d’ateliers et de petites fabriques, des journaliers, des employés, petits patrons comme des cordonniers-savetiers, des marchands de vin, des ouvriers du livre. Tous fortement politisés, patriotes et républicains, antireligieux. C’est parmi eux que se concentraient les revendications les plus à gauche durant les dernières années du Second Empire (qui ont pu s’exprimer enfin librement avec les lois sur la liberté de la presse de 1868), prônant pour les élections de 1869 un programme anticapitaliste de nationalisation des banques, assurances, mines et chemin de fer. Les partisans de Blanqui appellent depuis longtemps à l’insurrection. Par ailleurs les parisiens considèrent comme leur propriété ces canons qu’ils ont eux-mêmes payés par souscription lors de la guerre et ils se voient sans défense face aux troupes gouvernementales dont ils se méfient, dans le souvenir de juin 1848. Les femmes participent activement, inaugurant une véritable lutte égalitaire. L’historien Rougerie voit comme facteur de déclenchement « une tentative de réappropriation populaire de l’espace urbain », suite à la véritable confiscation engendrée par les aménagements haussmanniens[7]. Dans la lancée de l’insurrection parisienne, d’autres villes françaises instaurent une commune dès le 23 mars : Lyon, Marseille, Toulouse, Saint-Etienne, Le Creusot, Narbonne, Limoges, … mais elles sont très rapidement réprimées.
Alors que Thiers quitte Paris pour Versailles avec le gouvernement et que les habitants des beaux quartiers le suivent, le petit peuple de Paris s’organise. Des élections municipales se déroulent dès le 26 mars pour désigner les 92 membres du Conseil de la Commune. Le taux d’abstention est de 52 %, étant donné la population qui a déjà fui la guerre et celle qui a plus récemment quitté la ville avec Thiers. Les arrondissements de l’est et du nord (10e, 11e, 18e, 19e, 20e), puis du sud (12e et 13e) ont voté massivement pour les candidats fédérés tandis que les 1er, 2e, 3e, 9e et 16e ont plutôt voté pour les candidats du Parti de l’Ordre (environ 40 000 voix) avec des abstentions importantes. Finalement 70 élus seulement siègeront, du fait de la démission rapide de modérés, de l’impossibilité d’être à Paris pour certains (comme Blanqui arrêté) et des doubles élections. Le Conseil est représentatif des classes populaires et de la petite bourgeoisie avec : 25 ouvriers, 12 artisans, 4 employés, 6 commerçants, 3 avocats, 3 médecins, 1 pharmacien, 1 vétérinaire, 1 ingénieur, 1 architecte, 2 artistes peintres, 12 journalistes. Toutes les tendances républicaines et socialistes sont représentées : une vingtaine de néojacobins, un peu plus d’une vingtaine de radicaux partisans de l’autonomie municipale et d’une république sociale, une dizaine de blanquiste, quelques proudhoniens anarchistes, et une poignée d’indépendants. Peu de personnalités dominantes, mais deux groupes se dessinent : la majorité rassemble les jacobins, banquistes et indépendants, continuateurs de 1793, la minorité compte les radicaux, internationalistes et anarchistes, porteurs des mesures sociales. Au total ce Conseil est conscient de ses responsabilités, déterminé à œuvrer collectivement, au-delà des divergences de vue. Ainsi, lorsque la majorité vote la création d’un Comité de Salut Public, dans la plus pure tradition jacobine, la minorité autonomiste très opposée à cette formule autoritariste s’incline devant le résultat.
L’activité ne se réduit pas au Conseil de la Commune. Toutes la population parisienne est saisie d’une extraordinaire effervescence politique. Des cérémonies officielles, comme les obsèques de Pierre Leroux, l’installation du Conseil de la Commune rassemblent en masse ; de même que la destruction de symboles comme l’hôtel particulier de Thiers ou la colonne Vendôme. Des réunions se tiennent un peu partout, où s’expriment les aspirations de la population, des clubs s’organisent dans tous les quartiers (sauf les plus aisés), comme le Club de la Révolution de Louise Michel, et ils se fédèrent pour opérer une coordination avec le Conseil de la Commune. De nouveaux journaux paraissent, témoignant d’un formidable élan d’expression : plus de soixante-dix journaux sont créés pendant les soixante-dix jours de la Commune, un par jour en moyenne. La Commune administre Paris jusqu’au 20 mai en faisant preuve d’une activité législative considérable, la plupart des mesures n’auront pas le temps d’être appliquées et seront abolies après sa destruction, alors que certaines seront reprises par les différentes République bien ultérieurement, et que d’autres restent dans le domaine de l’utopie. Ce programme est absolument avant-gardiste : séparation de l’Église et de l’État, adoption du drapeau rouge, interdiction des retenues sur les traitements et salaires, instruction laïque gratuite et obligatoire, interdiction de l’enseignement confessionnel, nationalisation des biens religieux, justice gratuite et rendue par des jurys élus, abolition de la conscription, interdiction du cumul des mandats, ouverture de la citoyenneté aux étrangers.… Ces deux dernières dispositions ont décidément connu bien des mésaventures : Bien qu’au programme de la présidentielle de 2012 (142 ans plus tard), un an après elles ne sont toujours pas à l’ordre du jour de l’Assemblée, témoignant , pour la première, des tendances cumulardes ataviques des élus qui constituent une véritable oligarchie politique, et, pour la seconde, d’une frilosité bien en-deçà de l’esprit français.
Des mesures d’urgence sont prises : la levée des décrets gouvernementaux qui ont mis le feu aux poudres, concernant les loyers et les prêts ; solidarité pour les blessés, les veuves et les orphelins (des orphelinats sont mis en place avec le soutien de la population), les logements vacants sont réquisitionnés pour les sinistrés des bombardements, les ateliers abandonnés sont investis en coopérative ouvrières, prévoyant l’indemnisation des propriétaires, des bureaux municipaux de placement de la main-d’œuvre sont organisés, un salaire minimum est crée,… Côté travail la Commune trace les prémices de l’autogestion, et au niveau politique consacre, par l’appel du 22 mars une démocratie directe, reposant sur une citoyenneté active, les élus étant «révocables, comptables et responsables » devant le peuple. Renouant avec l’esprit de la Déclaration des droits de 1793, elle refait du droit à l’insurrection « le plus sacré des droits et le plus imprescriptible des devoirs ». Enfin, la Commune est le premier épisode politique français où l’émancipation des femmes est posée : l’union libre est reconnue, et des mouvements de femme revendiquent l’égalité des salaires (pour laquelle on doit encore légiférer en 2013 !) et leur place dans l’autogestion du travail.
Autogestion, démocratie directe et participative : Voilà des projets posés par la Commune qui restent à l’ordre du jour plus de 142 ans après !

Andrée Léo, Louise Michel et Paule Minck
« La guerre contre Paris »[8]
Thiers, dont la carrière politique a pâti des précédentes émeutes de 1848, souhaite prendre sa revanche contre le peuple parisien et organise méthodiquement la répression pour réduire la Commune. Toutes les tentatives de médiation et de conciliation entreprises par les maires, députés et franc-maçons de Paris, tels Clémenceau ou Victor Hugo, ont été refusées par le gouvernement et l’Assemblée. De même que la proposition d’échange d’un grand nombre d’otages contre la libération de Blanqui. Le drame devient inévitable : en accord avec les occupants prussiens qui y voient leur propre intérêt, tant ils craignent une résurgence de la Grande Révolution, le gouvernement lève une armée composée en partie de prisonniers libérés que les Fédérés parisiens, convoquant la mémoire révolutionnaire, appellent « les Versaillais ». Le 21 mai, cette armée entre dans Paris par la porte de Saint-Cloud et, durant une « semaine sanglante », va « nettoyer » sauvagement la capitale, d’ouest en est, barricade après barricade, fusillant toute personne surprise avec des armes, ou même avec des traces de poudre sur les mains, femmes et enfants compris, sans aucune pitié. Des quartiers entiers sont rasés au canon, avec le soutien des Allemands. L’histoire a retenu que les « Communards » (c’est ainsi que les officiels les nommaient), en faisant retraite d’ouest en est, avaient mis le feu à des bâtiments comme le palais des Tuileries, l’Hôtel de police, l’Hôtel de Ville, la Cour des Comptes, … alors que beaucoup de destructions sont aussi imputables aux troupes gouvernementales. La Commune s’achève par la défaite des insurgés au cimetière du Père Lachaise, le 28 mai.
Le bilan est terrifiant : environ 20 000 morts du côté de la Commune, hommes, femmes et enfants, pour la plupart exécutés sur place. Moins de 900 du côté des Versaillais. Durant cette semaine fatale, les troupes officielles se font aider d’indicateurs parmi la population parisienne. On a compté plus de 300 000 dénonciations avec à leur suite 36 000 arrestations, dont un millier de femmes et plus de cinq cent enfants. Ils sont parqués au camp de Satory, près de Versailles, dans des conditions épouvantables et inhumaines. Parmi eux Louise Michel et son compagnon Théophile Ferré, un des dirigeants blanquiste de la Commune qui sera condamné et fusillé aussitôt. Des tribunaux militaires d’exception opèrent sans relâche, prononçant plus de 400 condamnations à mort (toutes ne seront pas exécutées), 13 000 condamnations dont 7 500 à la déportation en Nouvelle-Calédonie. Plusieurs milliers de communards doivent s’exiler. Les lois d’amnistie n’interviendront qu’en 1880. Le mouvement socialiste est décimé pour au moins une décennie.
Il est difficile d’expliquer une telle férocité dans la répression qui est une véritable guerre civile de la majorité de la France, représentée par l’Assemblée, et soutenue amplement par l’armée d’occupation prussienne, contre Paris représentée tout aussi légalement par le Conseil de la Commune. La répression recueille une approbation générale dans le pays à cause de la peur récurrente des excès révolutionnaires parisiens et de l’écho que la presse et les organes officiels donnent à certains épisodes, comme l’exécution des otages dont l’archevêque de Paris. Elle reçoit également l’appui des principaux élus républicains de l’Assemblée nationale, comme Gambetta, Ferry, Favre, qui, en mémoire des insurrections de juin 48, considèrent sans hésitation que la Commune met la République en danger. La plupart des députés de Paris ne sont pas favorables à la Commune, même si Clémenceau, Blanc, et Hugo tenteront des médiations et condamneront sévèrement la répression. Hugo (qui était depuis longtemps en correspondance avec Louise Michel) démissionne et s’exile une nouvelle fois en proposant d’accueillir chez lui des anciens Communards. Une majorité d’écrivains sont également hostiles à la Commune, ainsi Flaubert, George Sand et Zola. Celui-ci condamnera néanmoins la répression qu’il a pu voir de près, étant resté dans Paris durant toutes ces journées. Il la décrit avec son verbe incomparable : « La tuerie a été atroce. Nos soldats… ont promené dans les rues une implacable justice. Tout homme pris les armes à la main a été fusillé. Les cadavres sont restés semés de la sorte un peu partout, jetés dans les coins, se décomposant avec une rapidité étonnante, due sans doute à l’état d’ivresse dans lequel ces hommes ont été frappés. Paris depuis six jours n’est qu’un vaste cimetière[9]. »
François Furet analyse que le socialisme français pâtira « de l’exil du mouvement ouvrier », et que les morts de la Commune « ont une nouvelle fois et plus profondément encore qu’en juin 1848, creusé le fossé qui sépare la gauche ouvrière et le républicanisme bourgeois[10] ». Au niveau symbolique, notons que la construction de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, lieu de départ du soulèvement parisien, a été décidé en 1873 par la Troisième République naissante, non pas pour célébrer la mémoire des morts de la Commune, mais pour « expier les crimes des fédérés » ! Cela en dit long sur la considération de la Commune dans la mémoire collective française encore éprise de religieux.
Postérité et destin de la Commune
L’éclosion de la Commune de Paris est à rapprocher des épisodes jacobins de 1793, lorsque la patrie était en danger, mais dans un odieux renversement, l’armée française, vaincue par l’ennemi extérieur se retourne contre une partie de son propre peuple révolté, les parisiens, qui souhaite continuer la lutte. A croire que la nouvelle assemblée et son gouvernement républicain, à majorité conservatrice, avaient plus peur des socialistes parisiens que des prussiens, à moins qu’ils n’aient voulu inconsciemment exorciser la défaite en se retournant contre les insurgés de l’intérieur, au lieu de chercher à fédérer leurs efforts. Fédérer, le terme honni ! Comme si s’être débarrassé de Napoléon III avait suffi aux bourgeois et aux monarchistes qui constituaient la majorité. Car les monarchistes espéraient une nouvelle restauration alors que les républicains en minorité souhaitaient instituer une nouvelle République. A quel prix ! L’historien monarchiste et maurassien Jacques Bainville[11], très lucide en l’occurrence, considère que la répression menée par Thiers a bénéficié très largement aux républicains qui ont montré dans cette épisode qu’ils pouvaient se détacher de la violence révolutionnaire et défendre l’ordre: « Ce fut la République qui signa la paix. Elle vint à bout de la Commune et rétablit l’ordre. Elle assuma toutes les responsabilités et elle en eut le bénéfice. Ce fut elle qui remplit le programme sur lequel la majorité de droite avait été élue. Alors les craintes que la République inspirait – révolution, guerre sans fin – s’évanouirent. Et ces causes réunies firent que le régime républicain, d’abord provisoire, devint définitif. » Il conclut : « C’est elle [la Commune]… qui a consolidé le régime républicain[12]. »
La Commune comme fonts baptismaux sanglants de la République ? Si elle fut à ce prix, la République devra un jour s’acquitter de cette dette : les Républicains pourront-ils s’affranchir des forces conservatrices auxquelles ils ont fait des concessions exorbitantes, contre leurs propres frères parisiens, pour enfin mettre en place des programmes sociaux novateurs ? La Commune de Paris appartient aux rapports complexes qu’entretient la France avec sa capitale. Une fois de plus, Paris fut en avance sur le temps de la France, et on peut se demander quand leurs épousailles auront lieu, tant le programme de la Commune a pris rendez-vous avec la France. Une fois de plus un épisode révolutionnaire parisien, court et fulgurant, fait référence et prend date avec l’histoire du pays et l’histoire des peuples. La Commune a inspiré de nombreux mouvements révolutionnaires, en France et à l’étranger (révolution russe et espagnole, en Amérique du Sud). Tel un atelier préparatoire, elle a expérimenté différents modes de gouvernance, dans le travail et dans la politique, qui demeurent dans la conscience des Français et restent à accomplir.
Epilogue historique de la Commune
Thiers chef de gouvernement puis Président de la République
Les monarchistes qui visent une nouvelle restauration ne sont pas fâchés que la répression de la Commune ne leur soit point imputable, de sorte que leur futur souverain ne pourra pas être entaché de tous ces morts. Ils prennent leur temps, laissant Thiers négocier le départ des troupes allemandes, ne souhaitant pas non plus charger leur souverain du fardeau de l’occupation étrangère. Thiers va obéir avec zèle à cette volonté plus ou moins exprimée de l’Assemblée à dominante royaliste, gagnant du temps pour asseoir son pouvoir.
Il faut tout d’abord payer l’indemnité de guerre de 5 milliards de francs exigées par l’Allemagne (correspondant environ à trois budgets annuels de l’époque). Thiers lance un grand emprunt public le 21 juin 1871 qui permet de réunir dans la seule journée du 27 juin plus de 4 milliards de francs. Les Allemands évacuent le territoire à mesure des paiements, et commencent par les quatre départements parisiens. Les ultimes versements interviendront en septembre 1873, et les dernières troupes d’occupation quitteront alors le pays. Ce grand emprunt a crée tout une classe d’épargnants qui vont participer à l’expansion boursière durant toute la fin du XIXe siècle.
Thiers entreprend dès le printemps 1871 des réformes administratives dans le plus pur style du centralisme français, mâtiné de démocratie locale : le préfet reste l’unique représentant de l’État dans le département ; le Conseil général continue à être élu au suffrage universel masculin, mais le département obtient le statut de collectivité territoriale. La nomination des maires qui restaient sous le Second Empire de la prérogative du préfet, est maintenant faite par le Conseil Municipal élu au suffrage universel masculin, sauf dans les villes de plus de 20 000 habitants où ils sont nommés par le gouvernement. Paris bénéficie d’un statut spécial, sans maire. La Commune a laissé des traces et on se méfie des grandes agglomérations et de Paris dont les majorités sont plus à gauche et peuvent perturber le jeu central. Plus tard, en 1872, le droit de vote sera enlevé aux militaires, souvent républicains ; dès lors l’armée devient « la Grande Muette ».
En août 1871, Thiers demande à l’Assemblée de préciser ses pouvoirs. Par la loi du 31 août 1871, il est nommé président de la République, au lieu de chef de gouvernement. Son mandat dure aussi longtemps que l’Assemblée qui peut cependant le révoquer à tout instant. Il nomme les ministres qui sont comme lui responsables devant l’Assemblée et ses actes sont contresignés par un ministre nommé vice-président su Conseil des ministres. Thiers impose son autorité à l’Assemblée divisée en trois blocs, les Légitimistes, les Orléanistes et les Républicains, en menaçant sans cesse de démissionner, jusqu’au point de rupture.
Les monarchistes qui se contentent de Thiers en attendant leur heure sont divisés en deux familles : les Légitimistes, héritiers de la monarchie de droit divin, ne souhaitent s’appuyer ni sur le peuple, ni sur le Parlement, ont comme héritier le Comte de Chambord, le fameux fils posthume du duc de Berry, et futur Henri V s’il accédait au trône ; Les Orléanistes souhaitent une monarchie parlementaire, adoptent le drapeau tricolore, et ont pour prétendant le Comte de Paris. On a du mal à croire de nos jours qu’une simple question de drapeau ruina les chances du Comte de Chambord. Celui-ci n’accepta nullement d’adopter le drapeau tricolore de la République, voulant restaurer le drapeau blanc de la monarchie de ses ancêtres. Chaque bloc en effet a besoin du secours d’un autre et c’est sur la question du drapeau qu’aucune majorité n’a pu se dégager. Comme quoi le drapeau a son importance, et rassemble ou divise selon le symbole dont il est porteur. Voyant l’échec d’une restauration, Thiers invoque par un discours de novembre 1872 à la Chambre, le retour d’une République « le régime qui nous divise le moins » précise-t-il et qu’il voit « socialement conservatrice et politiquement libérale ». Belle définition du conservatisme républicain et du libéralisme qui n’a cessé de se développer en Occident jusqu’à nos jours. On pardonnera toujours à la droite sa « réaction » antisociale, sous prétexte qu’elle est républicaine : A croire que même de nos jours la République reste un exploit !
L’omniprésence républicaine de Thiers indispose de plus en plus l’Assemblée à mesure que les occupants se retirent et que la situation s’améliore. Une loi, dite loi De Broglie, ou « loi chinoise » (par dérision à un cérémoniel chinois), est votée le 13 mars 1873 limitant les prérogatives du président au profit des ministres et de l’Assemblée. Ce dernier ne peut plus espérer un débat à l’Assemblée. Cette loi restera en vigueur durant toute la Troisième République. Comme le 15 mars est votée l’évacuation définitive des troupes allemandes, le Parlement n’a plus besoin de Thiers dont il va se débarrasser rapidement. Une union des droites est constituée autour d’Albert de Broglie, pour pousser le parlement à une politique résolument conservatrice, et Thiers mis en minorité, démissionne le 24 mai. Le général Mac Mahon, légitimiste qui a réprimé la Commune, est aussitôt nommé président de la République.
Le retour de l’ordre moral, légitimiste et catholique : Mac Mahon président pour 7 ans
Mac Mahon le déclare d’emblée : avec l’aide de Dieu, de l’armée et des honnêtes gens, il souhaite « rétablir l’ordre moral dans le pays ». Pour cela l’Eglise est fortement encouragée à reprendre son emprise par des pèlerinages et autres cérémonies, d’autant que les enterrements civils sont prohibés. Des mesures antirépublicaines radicales sont prises : censure de la presse, annulation de la commémoration du 14 juillet, les bustes de Marianne sont retirés des mairies, et, plus grave, la nomination des maires est à nouveau confiée aux préfets et représentants de l’Etat. Cette mesure sera fatale à cette assemblée conservatrice : les élections de 1876 consacreront la victoire des Républicains.
La seule ambition de Mac Mahon semble être de restaurer la royauté. La politique ultraconservatrice a dégagé une majorité pour cela, les Légitimistes et les Orléanistes se sont mis d’accord sur le retour du Comte de Chambord, alias Henri d’Artois, au détriment de Philippe d’Orléans, en contrepartie d’un retour de la lignée d’Orléans en cas d’absence d’héritier légitime. Curieusement c’est le Comte de Chambord lui-même qui ruine toute chance de retour en refusant encore une fois de renoncer au drapeau blanc. Comme ce dernier est âgé, les Orléanistes n’ont plus qu’à attendre sa disparition : En novembre 1873, l’Assemblée se met d’accord pour renouveler, pour sept ans, le mandat de président de Mac Mahon. Mais à la chambre l’opposition républicaine, bien que minoritaire, est coiffée par Gambetta qui ne désarme pas sur les valeurs et qui se positionne en inlassable partisan d’une véritable République, influençant à sa manière la mise en place des institutions.
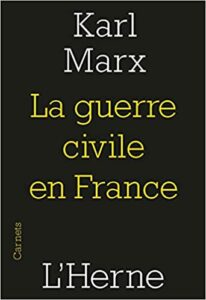
[1] Karl Marx, La Guerre Civile en France.
[2] François Furet, op. cit. p. 768.
[3] Karl Marx, op. cit.
[4] Wikipédia, Troisième République ; Assemblée nationale 1871 ; Traité de Francfort.
[5] Selon Marx : « Le véritable meurtrier de l’archevêque Darboy, c’est Thiers. La Commune, à maintes reprises, avait offert d’échanger l’archevêque et tout un tas de prêtres par dessus le marché, contre le seul Blanqui, alors aux mains de Thiers. Thiers refusa obstinément. Il savait qu’avec Blanqui, il donnerait une tête à la Commune », Karl Marx, La guerre civile en France (la commune de Paris), 1871, éd. Fayard/Mille et une nuits (2007) ; p. 70. Wikipédia, Auguste Blanqui.
[6] Wikipédia, La Commune de Paris ; Louise Michel ; La Semaine sanglante.
[7] Wikipédia, La Commune de Paris, Le contexte social parisien.
[8] En référence au titre de l’ouvrage de Robert Tombs, La Guerre contre Paris (1871)
[9] François Furet, op. cit. p. 759, citant l’extrait d’un article de Zola pour le journal marseillais Le Sémaphore.
[10] François Furet, op. cit. p. 759.
[11] C’est lors de ses funérailles à Paris, en février 1936, que Léon Blum dont la voiture munie de la cocarde s’est trouvée coincée dans la foule, a été pris à parti par des camelots et blessé grièvement, échappant de peu au lynchage grâce à des ouvriers venus à la rescousse. Wikipédia, Jacques Bainville.
[12] Wikipédia, Troisième République, La Commune, citant l’Histoire de France de Jacques Bainville paru en 1924

Le 18/12/2020


1 réflexion sur “La Commune de Paris : Suite et fin de la Révolution, ou prémices d’une véritable République sociale ?”
150 ans ça fait retours de Chiron!