Napoléon le fils glorieux de la Révolution
La France célèbre le 5 mai 2021 le bicentenaire de la mort de Napoléon, personnage hors du commun dont j’ai tenté de dégager le rôle singulier dans l’accomplissement du destin tout aussi singulier de la France, dans mon ouvrage La Destinée de la France, essai sur une astrologie des civilisations, avec l’aide de nombreux historiens.
J’ai en particulier montré que son rôle avait été de sauvegarder et mettre en œuvre au niveau intérieur les acquis de la Révolution et, au niveau extérieur, de résister à la pression des Empires européens qui en voulaient leur perte, tout « en semant les idées de la Révolution en Europe »
selon l’expression de l’historien britannique Eric J. Hobsbawm.
Voici des extraits significatifs de mon ouvrage qui vous inciteront, je l’espère, à le lire en entier.
L’armée révolutionnaire, « enfant la plus redoutable de la république jacobine »[1]
Autant le régime stagnait dans l’inaction, autant l’armée allait de victoire en victoire, apportant des butins et des conquêtes à un gouvernement pourtant inerte. Pas étonnant alors que Napoléon Bonaparte, le plus intelligent et le plus avisé de ses généraux, ait eut l’idée que l’armée pouvait très bien se passer d’un régime civil si inefficace !
Fruit d’une « levée de masse » de citoyens révolutionnaires, l’armée devint bientôt une force de combattants professionnels. Il n’y eut pas de nouvelle levée entre 1793 et 1798 et ceux qui n’avaient pas de goût pour les armes désertèrent en masse, ne laissant que ces nouveaux privilégiés qui avaient trouvé dans l’armée un destin, à l’image de leur futur général. L’armée devenait une carrière comme toutes les autres, ouverte à tous les talents. Elle garda de la révolution cette supériorité militaire incomparable, mélange de morgue due au sentiment de sa mission révolutionnaire, de fierté individuelle et nationale due à la véritable reconnaissance du courage, (la promotion avait lieu au simple mérite et c’est tout à fait nouveau ), que le génie militaire de Napoléon allait exploiter. Les nouveaux étaient formés par les anciens et, reconnus comme des hommes, avaient toute opportunité de s’intégrer par leur audace et leur bravoure. Au niveau de l’intendance, cette armée ne nécessitait pas beaucoup de moyens puisqu’elle vivait sur le pays occupé. Elle remportait les victoires tellement vite qu’elle n’avait pas besoin non plus d’armes en abondance.
Depuis 1792, et jusqu’en 1815 avec Napoléon, la France est en guerre quasiment ininterrompue non seulement contre les pays limitrophes, mais contre tout le reste de l’Europe. En représentante de la Révolution, elle appelle les peuples à se libérer de la tyrannie et à embrasser la liberté. S’oppose à elle toutes les puissances soucieuses de conserver leur pouvoir royal ou impérial, ou leur prérogative économique et commerciale, dans le cas de la monarchie constitutionnelle anglaise. Dans le premier cas il s’agit d’une véritable guerre idéologique, alors que dans le second c’est plutôt un conflit économique, à l’image de la lutte entre Rome et Carthage[2].
L’écho européen aux idées révolutionnaires
L’intelligentzia européenne se sentait proche de la Révolution, à l’image des philosophes allemands Kant, Herder, Schelling et Hegel, le poète Schiller, le musicien Beethoven ( ce n’est qu’après que Napoléon se fût nommé empereur que ce dernier revient sur la dédicace qu’il lui avait faite de la Symphonie héroïque). En Angleterre, la Révolution avait un incomparable interprète en la figure de Thomas Payne qui vendit plus d’un million d’exemplaires de son ouvrage Les Droits de l’Homme paru en 1791-92 et s’il dut s’exiler en France justement, il n’en resta pas moins un phare. En Italie tous les courants éclairés anticléricaux sont en sympathie. Ces appuis idéologiques, que l’on retrouve romancé chez Stendhal dans la Chartreuse de Parme, ne sont pas, pour la France, d’une importance déterminante au niveau politique et encore moins militaire. Mais ils sont le signe du rayonnement de la France du à ses idées concernant les Droits de l’homme et des peuples à se libérer de la tyrannie. Les alliés de la France n’étaient que des partis ou groupements à l’intérieur des pays, et ne prenaient pas une envergure nationale, sauf peut-être en Pologne qui essayait de se libérer de l’étau des trois puissances russe, prussienne et autrichienne, et emprunta une réforme constitutionnelle en 1791 proche de celle de la France ; ou encore en Irlande qui cherchait des alliés contre les Anglais. Ce mouvement très pro-français et qui avait lancé une insurrection importante en 1797/1798, aurait pu être exploité valablement pour obliger les Anglais à signer la paix, alors qu’ils restaient les seuls belligérants, mais le projet d’invasion de ce pays par Hoche, mal préparé et contrarié par de grosses tempêtes fut abandonné.
Cependant, dès 1789, les nouvelles idées révolutionnaires avaient essaimé dans les pays limitrophes, en Belgique, Suisse, et aux Pays-Bas. En Suisse des forces de gauche dans certains cantons protestants avaient toujours été fortes, et la révolution s’installa à Genève dès 1792, trouvant après la conquête française un véritable soutien et non une cause à sa révolte. La Belgique était déjà en pleine révolte en 1789 (n’oublions pas le titre de l’ouvrage de Camille Desmoulins : Les Révolutions de France et de Brabant) et sa partie révolutionnaire, quoique minoritaire face au camp conservateur, vit d’un bon œil la conquête française. La Belgique fut annexée en 1795 ; les Pays-Bas devinrent la République batave la même année, et par la suite un royaume familial des Bonaparte. La Suisse devint la République helvétique en 1798, et fut finalement annexée. En Italie, une kyrielle de républiques furent créées : la République cisalpine et la république ligure, en 1797 ; la République romaine et la république de Naples en 1798 ; elles devinrent ensuite partiellement territoire français, mais surtout des états satellites : le Royaume d’Italie, le Royaume de Naples.
La montée en puissance de Bonaparte
Napoléon Bonaparte naquit le 15 août 1769, en Corse, alors que l’île, qui appartenait à la République de Gènes, vient d’être rattachée à la France depuis un an. Deuxième enfant d’une famille de huit, de la petite noblesse italienne, dont le père est franc-maçon et proche d’un célèbre indépendantiste, Pascal Paoli, et la mère d’une grande beauté et d’une force maternelle toute insulaire, il rejoint jeune le continent pour faire des études militaires. Il parle corse mais aussi le français auquel il se plie, considérant dans un premier temps les Français avec méfiance, comme des ennemis, et ils le lui rendent bien. Car sa situation est bien en-dessous de celle de ses camarades et il ne s’en accommode point, écrivant à son père à 14 ans, pour lui demander plus de subsides ou sinon l’autorisation de quitter l’école de Brienne : «j’aime mieux être le premier d’une fabrique que l’artiste dédaigné d’une académie[3] ». Il est admis à l’Ecole Militaire de Paris en 1784, puis, au lieu de la marine qu’il aurait préféré, rejoint l’artillerie sous l’injonction de sa mère. Son père qui a définitivement rejoint le parti français décède en 1785 et il se sent le chef de famille, considérant son frère Joseph trop faible pour assurer la fonction. Il fait vivre quasiment toute la famille avec sa solde et revient fréquemment en Corse, demandant permissions sur permissions, alors qu’il aurait pu déjà inscrire son destin sur les champs de bataille glorieux de Valmy ou de Jemmapes[4]. Il croit peut-être à ce moment-là que sa destinée se joue sur cette ile où il tente, à la suite de son père, de poursuivre avec leur ami Paoli le rêve d’indépendance corse. Il pense que la Révolution peut le permettre et, dans cette période effervescente où tous les clans s’agitent, il joue sur les deux tableaux, ne lâchant pas le parti français. Il participe à l’expédition de Sardaigne, un échec qu’il impute aux défauts de commandements de Paoli, dont il transmet l’analyse détaillée au ministère de la guerre. Il finit par comprendre la duplicité du dirigeant corse qui fraye avec les Anglais, et s’éloigne de lui, autant que celui-ci le repousse, malgré l’amour qu’il ne cessera de ressentir à son égard. Son frère Joseph et un ami député dénoncent à la Convention les menées de Paoli, si bien qu’en mai 1793, toute la famille est bannie par l’Assemblée corse et vouée à « une perpétuelle exécration et infamie »[5]. Ils quittent la Corse à bord du « Hasard » ! Ce véritable traumatisme propulse définitivement Napoléon vers sa destinée française ayant, par ce bannissement, définitivement obtenu un brevet de patriotisme. Le « Hasard » les débarque au cœur d’un théâtre d’opération révolutionnaire, à Toulon, en proie, comme une partie du Midi, à l’insurrection girondine contre la Convention montagnarde et, plus grave, le port est occupé par les anglo-espagnols, livrés par les notables girondins de la ville contre protection. Une armée révolutionnaire en fait le siège pour reprendre la place. Peu de temps après, il met sa compétence d’artilleur au service et on lui confie des charges même infimes où se distingue toujours son fameux esprit de principauté décelé par sa mère. Sa première occasion véritable d’ascension, il la doit à un compatriote corse, Saliceti, envoyé de la Convention, qui lui confie le commandement provisoire de l’artillerie en remplacement d’un général grièvement blessé. Sa stratégie fera merveille. Après l’expulsion de l’ile natale, le siège de Toulon devient sa véritable rampe de lancement : en quatre mois, de septembre à la victoire du 19 décembre 1793, où les troupes étrangères quittent la ville libérée, Bonaparte arrivé simple capitaine et parfaitement inconnu, repart général, le 22 décembre, rejoindre sa nouvelle affectation à Nice. Estimé et repéré de révolutionnaires notoires, comme Barras, Fréron, ou le propre frère de Robespierre, il a révélé son talent de stratège et commencé à tisser de futurs réseaux parisiens. Profondément jacobin, il croit que seul le pouvoir de Paris peut maintenir l’autorité dans le pays. Las, sa fortune tourne avec le 9-Thermidor : accusé de trahison, arrêté et assigné à résidence à Nice, il est sur le point d’être traduit devant le Comité de salut public. Il échappe à la purge, mais végète quelques mois à Paris, en proie à de sombres pensées suicidaires. L’insurrection royaliste contre la Convention, le 13 Vendémiaire an IV (5 octobre 1795) le sauve : Barras le charge de la disperser, ce qu’il fait avec succès en faisant canonner les insurgés sur les marches de l’église Saint-Roch ; Il fait figure de sauveur de la République et, dix jours plus tard, il est nommé général de division, puis commandant de l’armée de l’intérieur. Il est considéré comme le bras armé de Barras. « Il va tout lui devoir, sa sortie de la misère, sa femme, ses nominations[6].» Barras croit se servir de Napoléon Bonaparte, alors que c’est l’inverse qui se produit graduellement. Pour l’heure, son coup de foudre pour Joséphine de Beauharnais, ancienne maîtresse de Barras, défie la raison : bien qu’elle soit plus âgée que lui, et fort peu attirée par cet homme pressé et vif, encore inconnu, elle l’épouse sans pour autant renoncer à sa vie de liberté et de plaisirs. Le père de ses enfants a été guillotiné et elle a échappé de peu à la mort. Au temps de la terreur a succédé une folle frénésie de vivre, et elle va s’accommoder fort bien des éloignements fréquents de son nouvel époux. Deux jours après son mariage, il est nommé à la tête de l’armée d’Italie qui manque cruellement de moyens, de munitions, de souliers et d’espoir : bientôt, grâce à lui, elle aura tout, y compris la gloire !
La campagne d’Italie

Cinq victoires en dix-sept jours, le destin de Bonaparte dépasse désormais son propre sort pour embrasser, depuis l’Italie, la destinée de la France. En novembre 1795, son assaut vers le pont d’Arcole, un drapeau à la main, à la tête de ses troupes, alors que tout semble perdu, lui arrache son aide de camp, ami et ange-gardien, Jean-Baptiste Muiron[7], mais le fait entrer dans la légende. La victoire de Rivoli, en janvier 1797 est décisive. Alors qu’il était surtout chargé de faire diversion pour dégager les armées de Jourdan et Moreau de la pression des Autrichiens, sur le Danube et le Rhin, et que sa propre armée était mal équipée et mal nourrie, Bonaparte retourne la situation à son avantage : il vainc successivement cinq armées piémontaises et autrichiennes, conquiert l’Italie en un an, de 1796 à 1797, et oblige l’Autriche à abandonner la rive gauche du Rhin. Désormais, le Directoire lui doit tout, et Bonaparte, installé au château de Milan, négocie lui-même les traités : Il donne à la France une partie du Piémont, fonde deux républiques en Lombardie, conquiert toute l’Italie, depuis le Tyrol jusqu’au Tibre, signe des traités avec les souverains du Piémont, de Parme, de Naples, de Rome. Le Directoire, dont il a éclipsé la considération et le pouvoir, l’invite à poursuivre ses conquêtes et à marcher sur Vienne. Le Royaume de Piémont-Sardaigne et l’Autriche finissent par se retirer de la première coalition qui se trouve ainsi dissoute. C’est la paix de Campo-Formio, venue conclure en octobre 1797, les accords préliminaires de Leoben, et signée entre Bonaparte et le représentant l’Autriche, à qui est livrée une des plus anciennes républiques d’Europe, la République de Venise. Désormais ne reste que l’Angleterre en conflit avec la France. Mais comment frapper ce pays protégé par son insularité, puissance dominante sur les mers ? Comme nous l’avons évoqué, Hoche a raté une opération en Irlande en 1796, à cause d’une tempête.
Culte républicain, instruction publique et grandes écoles
Le civisme républicain est prospère sous la république thermidorienne et le calendrier révolutionnaire trouve son plein emploi. Les Eglises, rebaptisées temples, sont désormais utilisées à trois cultes : celui de l’Eglise catholique constitutionnelle, la théophilantropie (mouvement apparu en 1796, dans le prolongement du culte de la Raison et de l’Etre suprême, proposant une religion naturelle d’amis de Dieu et des hommes), et la cérémonie républicaine officielle du décadi où les citoyens célèbrent les lois autour des autorités municipales, et où, comme à l’église autrefois, il est de bon ton de se montrer, cette fois pour être en bons termes avec le gouvernement[8].
Les grandes ambitions en matière éducative datent de 1793, où ont été débattus les plans d’éducation de Condorcet puis du robespierriste Le Peletier qui stipulait l’obligation de l’enseignement primaire aux frais de l’état. Les mesures pratiques ont été votées après Thermidor et mises en place sous le Directoire. Les Montagnards destinaient ces mesures d’éducation publique et laïque à tous les enfants de la République, tandis que le Directoire s’intéresse en priorité aux enfants des propriétaires, c’est pourquoi l’enseignement primaire est sacrifié : l’instituteur redevient payé par les communautés locales comme avant 1789, et l’obligation scolaire n’est plus spécifié. Dans les faits, «on retourne à l’ancien système, et bien des petites écoles à demi-clandestines sont rouvertes sous la houlette d’un prêtre réfractaire réapparu en pédagogue, faisant concurrence à l’instituteur public soutenu par l’administration »[9]. L’instruction obligatoire et la laïcisation de l’enseignement devra attendre plus de quatre-vingt ans pour réapparaître avec Jules Ferry. L’effort des thermidoriens puis, à leur suite, du Consulat et de Bonaparte, portera essentiellement sur le secondaire et le supérieur, avec des écoles « centrales » au chef-lieu de chaque département, puis tout un réseau d’établissements supérieurs qui auront une longue postérité : Conservatoire des Arts et Métiers, Ecole des services publics, pour l’armée, la marine et les ponts et chaussées qui deviendra l’Ecole polytechnique ; trois écoles de médecine, à Paris, Lyon et Montpellier, l’Ecole normale supérieure, chargée de former les professeurs, l’Ecole des langues orientales, le Muséum, l’Observatoire,… Ces établissements forment encore les élites d’aujourd’hui. Enfin, cette même loi d’octobre 1795 sur l’organisation de l’instruction publique, place en haut de l’édifice éducatif, l’Institut de France, coiffant l’ancienne Académie française, et répartissant l’ensemble des disciplines en trois classes : sciences physiques et mathématiques, littérature et beaux-arts et, grande nouveauté, les sciences morales et politiques. « C’est le pouvoir spirituel du régime[10] », prévu dans la Constitution, et peuplé des grands notables de la science et de la vie publique : Monge, Berthollet, Lagrange, Lamarck, Geoffroy Saint-Hilaire, Daunou, Chénier, Cabanis. Bonaparte, revenu d’Italie après Campo-Formio, s’y fait élire en 1797, à la place de Carnot qui s’est exilé après Fructidor :
Ce passage du héros de l’Italie chez les hommes de pensées est un bon investissement. La France est toujours ce pays qui aime la littérature et les idées. Dieu sait que les rescapés qui la dirigent ont redécouvert les intérêts, mais ils ont gardé de 1789 le projet fondamental de fonder la société sur la raison, et c’est un trait qui marquera leurs héritiers jusqu’au XXe siècle. Pour l’élite politique et intellectuelle de l’époque, ce projet a pris la forme de ce qu’elle appelle l’ «idéologie », qui est la doctrine régnante, dernière-née des Lumières, et qui va fermer l’époque. C’est un rationalisme expérimental, qui écarte toute explication métaphysique de la connaissance, tout relais par Dieu et par l’innéité, et veut fonder une science de la formation des idées à partir des sens[11].
L’expédition en Egypte

Bonaparte, de retour à Paris, admis à l’Institut, est l’étoile montante du Directoire dont les dirigeants ne peuvent rien lui refuser tant il les a couverts d’œuvres d’art, de gloire et de richesses à travers cette campagne victorieuse. Il examine un temps un débarquement en Angleterre auquel il renonce, et il lui vient à l’idée d’aller frapper l’Angleterre en Egypte. Cette stratégie de couper en Egypte le commerce des Anglais avec l’Inde, est soutenue par le vénal ministre des Affaires étrangères Talleyrand, dont on se demande s’il ne l’a pas fait pour complaire à l’Angleterre en détournant les navires français de la Manche vers l’Orient. Toujours est-il que Bonaparte prépare avec enthousiasme ce qu’il préfère nommer une expédition plutôt qu’une campagne, car il embarque avec lui l’élite des scientifiques français. En Egypte il met ses pas dans les traces de César et d’Alexandre, et fait découvrir aux Français et au monde, à travers le patient travail de recueil des chercheurs, par des dessins, schémas et planches nombreuses, toutes les richesses et la magnificence de l’ancienne culture égyptienne. Victorieux des guerriers mamelouks, battant aussi les troupes du sultan, il organise un protectorat éclairé et tolérant et s’installe au Caire durant un an, comme il l’a fait à Milan lors de la campagne d’Italie. Mais celui qui deviendra son plus redoutable adversaire, l’amiral britannique Nelson, coule la flotte française dans la rade d’Aboukir, et il doit quitter l’Egypte en secret, avec toute l’équipe de scientifique, abandonnant son armée sur place et louvoyant en Méditerranée pour ne pas tomber aux mains des Anglais.

Un contact de Bonaparte avec la grande Tradition égyptienne n’est pas à exclure, et certains auteurs s’en font les porte-voix. Il aurait en effet passé, seul, une nuit dans la grande pyramide, à la veille de son anniversaire d’août 1799, et il en ressortit silencieux et transformé, se bornant à déclarer que s’il racontait ce qu’il avait vécu, personne ne le croirait. A-t-il été initié par un grand prêtre ? A-t-il eu la vision fulgurante de son destin ? Ce qui expliquerait son ascension sans accrocs et sa détermination sans faille, quelles que soient les circonstances, même les plus contraires. Depuis la plus haute Antiquité tous les êtres au destin d’exception ne sont-ils pas passés par l’Egypte : Alexandre-Le-Grand, Pythagore, Jésus ?…
Vers le 18-Brumaire
Durant le temps qu’il reste absent de France, du printemps 1798 à l’automne 1799, interviennent les premières révoltes des peuples occupés contre l’oppression française, qui ne maintient du messianisme émancipateur des conquêtes d’origine que l’abolition de la dîme et des droits féodaux personnels. Mesures bien maigres face à l’occupation militaire de soldats qui vivent sur le pays et pillent systématiquement les richesses locales. Si bien qu’à la fin de l’hiver 1799, la guerre reprend entre le Directoire et l’Europe, et l’armée française évacue le sud de l’Italie, secouée par des révoltes paysannes, pour rassembler ses forces. L’Angleterre réussit à renouer une coalition (la deuxième) avec le tsar et le roi de Naples. La France n’arrive pas à monter une alliance avec la Prusse, malgré les efforts de Sieyès, envoyé en ambassade, et l’Autriche glisse à nouveau vers la guerre qui reprend à l’hiver 1798/99. Au printemps et à l’été 1799, la situation militaire fait resurgir les souvenirs de la patrie en danger et une levée en masse est décidée, ainsi qu’un emprunt forcé sur les riches. A l’Ouest la révolte chouanne n’est non seulement pas tarie mais resurgit de plus belle, des émeutes royalistes reprennent aussi dans le Midi. Mais la force de la République n’est plus dans les sections ou dans le peuple, elle est maintenant dans son administration. Sieyès, une des mémoires vives de la Révolution est entré au Directoire. « La Révolution est revenue dans les mains de son inventeur. L’ancien vicaire de Chartres s’est rendu maître de l’exécutif, avec la complicité de la gauche des Conseils, Lucien Bonaparte en tête, député de la Corse qui ne le quitte plus[12].» Au Directoire, Sieyès n’a plus qu’un rival, Barras, en place depuis le début et, de ce fait, usé et symbole du discrédit qui touche le Directoire. Aussi, ayant traversé tous les régimes, capable de nouer des alliances dans tous les bords, Sieyès fait office de sauveur « civil » en attendant le sauveur militaire, mais il n’est plus que « le mandataire d’une oligarchie de rescapés[13] ». Le retour de Bonaparte qui traverse la France depuis Fréjus, dans une sorte d’acclamation collective et de triomphe ininterrompu, donne à Sieyès la conviction que l’épée du coup d’état auquel il pense depuis juillet, ne peut être que celle de Bonaparte. A partir du 10 Brumaire (1er Novembre 1799), l’affaire est entendue : il s’agit de former un gouvernement de trois consuls, chargés de faire une nouvelle constitution avec l’aide d’une commission parlementaire.
Le projet se conclut en deux jours, les 18 et 19 brumaire. Le 18 brumaire, le coup d’état sous prétexte d’un complot anarchiste, est réussi, les directeurs dont Barras démissionnent, les ministres et l’administration se rallient pour « sauver la République ». Le lendemain, les Conseils des Cinq-cents et des Anciens, contraints à se réunir à l’orangeraie de Saint-Cloud, se rebellent avant qu’une démonstration de force de l’armée les convainque d’accepter ce que Sieyès leur demande : le remplacement du Directoire par une commission exécutive composée de trois consuls. Trois consuls qui seront Sieyès, Bonaparte et Roger Ducos[14]. Dès le soir, ceux-ci prêtent serment auprès des deux conseils, d’être fidèles « à la souveraineté du peuple, à la République une et indivisible, à la liberté, à l’égalité et au système représentatif. » Les Cinq-cents déclarent que les généraux et les soldats qui, le matin, les avaient chassés de l’orangeraie, avaient bien mérité de la patrie.
Le coup d’état a réussi de peu, mais ne fut pas, sur le moment, pris comme un épisode aussi décisif qu’il le fut en réalité, de mettre fin à la Révolution en instaurant un régime despotique fondé sur l’autorité d’un seul.
Le fils glorieux de la Révolution
Dix ans après 1789, la Révolution française est largement devenue dans l’opinion publique ce quelque chose de très particulier qui échappe à l’analyse de Constant : un nationalisme universaliste, où l’historien retrouve ses éléments constituants, faits de passion antiaristocratique et de rationalisme, transfigurés par l’idée d’une élection historico-militaire de la nation. A cet ensemble de sentiment le Directoire ne peut pas plus donner un visage qu’il n’est capable de rassurer les intérêts menacés. Des deux côtés il y a la demande implicite d’un roi, mais d’un roi qui soit radicalement différent des rois, puisque né de la souveraineté du peuple et de la raison. C’est là que nait Napoléon Bonaparte, roi de la Révolution française. En 1789, les Français avaient fait une république sous le nom d’une monarchie. Dix ans plus tard, ils font une monarchie sous le nom d’une République[15].
Le pouvoir, on le lui imposa autant qu’il le saisit, lorsque les invasions militaires de 1798 révélèrent combien le Directoire était faible et combien il était lui-même indispensable. Il devint premier Consul ; puis Consul à vie ; puis Empereur. Et avec son arrivée, comme par miracle, les problèmes insolubles du Directoire se trouvèrent résolus. En l’espace de quelques années, la France eut un code civil, un concordat avec l’Eglise et même, symbole frappant de stabilité bourgeoise, une banque nationale. Et le monde eut son premier mythe séculaire[16].
Ce raccourci saisissant ne suffit pas à comprendre l’avènement de Bonaparte puis de Napoléon que celui-ci tissa fermement et rapidement à partir du 18 Brumaire, utilisant l’antagonisme entre les deux autres consuls pour faire sa place. Car il n’était au début que le troisième consul… et avant la fin de l’année 1799, la Constitution de l’an VIII l’installe au pouvoir comme premier Consul. Le vote populaire qui a été rétabli n’est destiné, à tous les échelons du pays, des communes au sénat, qu’à fournir des listes de notabilité au sein desquelles le tri est opéré par le haut. Bien que le pouvoir continue à se réclamer du peuple, il n’est plus contrôlé par lui. Ainsi s’instaure peu à peu un véritable despotisme éclairé, qui continue à se référer aux valeurs de la Révolution, mais dont les décisions sont concentrées aux mains d’un seul. Sieyès devient président du sénat et « disparait sous les honneurs, dans les débris de ses propres idées[17] ». Pour gouverner, Bonaparte s’entoure d’un homme de la Révolution, Cambacérès, ancien Conventionnel et régicide (ayant voté le sursis), et d’un serviteur de l’Ancien Régime, Lebrun. Mais cette réconciliation nationale à travers les deux hommes n’efface en rien les acquis révolutionnaires que Bonaparte, par conviction sans doute autant que par calcul, s’efforce de défendre à l’intérieur comme à l’extérieur. Il se sait le fils de la Révolution et de la République et, comme en témoignent ses écrits postérieurs, s’efforcera toujours de s’y référer sinon d’y rester fidèle, à sa manière toute personnelle. Au niveau intérieur, il se fait aider par le redoutable Fouché, Ministre de la police, qui contrôle les esprits et manipule les médias, et aux Affaires étrangères c’est l’inusable Talleyrand qui continue de sévir, traversant avec profit tous les régimes.
Consul, il mêle les qualités d’un héros républicain et d’un chef d’état bourgeois, agrémentant le tout de son caractère bouillonnant et despotique. Il travaille, il décide, il ne perd pas son temps dans des cérémonials de cour à l’ancienne, il est toujours entouré de ses fidèles généraux, il va non seulement incarner la nation nouvelle, comme avant lui Mirabeau ou Robespierre, il va l’accomplir[18]. Lucide, il sait d’où il vient et pourquoi il est là, et il est au rendez-vous de l’histoire : « Ce n’est pas comme général que je gouverne, mais parce que la nation croit que j’ai les qualités civiles propres au gouvernement ; si elle n’avait pas cette opinion, le gouvernement ne se soutiendrait pas. Je savais bien ce que je faisais lorsque, général d’armée, je prenais la qualité de membre de l’Institut ; j’étais sûr d’être compris par le dernier tambour. Il ne faut pas raisonner des siècles de barbarie aux temps actuels. Nous sommes trente millions d’hommes réunis par les Lumières, la propriété et le commerce. Trois ou quatre cent milles militaires ne sont rien auprès de cette masse[19]. »
Au niveau légal il construit l’état moderne, à partir des acquis de la Révolution, en les colorant de hiérarchie et d’ordre patriarcal et familial, selon son propre caractère autoritaire. Et cela convient à un peuple à dominante rurale, à la fois révolutionnaire et conservateur, soucieux de préserver la propriété et l’ordre, et qui se soumet volontairement à ce despote éclairé par les Lumières, au panache certain, et qui en impose par les armes aux éternels ennemis de la France et de la République. Le travail d’unification juridique et de législation était en cours avant lui, mais il va l’accélérer et le parachever en imposant sa marque, à la fois corse et militaire, qui met l’ordre et l’autorité au-dessus de tout. Il met en place un système administratif, véritable nerf de l’état, qui est destiné à transmettre la volonté du centre jusqu’aux lieux les plus reculés. Il anime l’administration de son esprit vif et toujours en alerte et les choses ne vont jamais assez vite pour lui. A travers le Code civil, encore nommé Code Napoléon, il introduit l’universalité de la loi, contre tous les pouvoirs locaux ou nationaux, y compris, pourrait-on dire, contre lui-même ! Il a résolu la crise de la représentation politique qui a caractérisé la Révolution, en devenant l’unique représentant et malgré cela, il réussit le prodige de s’ériger lui-même en défenseur de l’intérêt général et en garant de la souveraineté populaire pour faire la loi puis la faire respecter, de manière identique pour chaque citoyen. Lui et son administration restent le symbole d’un état nouveau, « fondé sur le consentement de citoyens égaux et porteur de l’intérêt général [20]».
Napoléon confirme les acquis de 1789 et 1792 : la société d’individus libres et égaux, la liberté des consciences, des contrats, du travail, la laïcité de l’Etat. Mais le nouveau droit est beaucoup plus conservateur, notamment en ce qui concerne la famille. La puissance paternelle, héritée du droit romain et qui avait été mise en cause par la Convention est réaffirmée ; elle assoit le pouvoir du père de famille sur son épouse et sur ses enfants, mais les limite pour ceux-ci jusqu’à leur majorité. L’égalité des sexes proclamée (mais peu mise en application) par la Convention est récusée par le Code Napoléon, qui insiste sur la subordination de l’épouse à son mari : elle est frappée d’incapacité en ce qui concerne tous les biens du ménage, et reste sous la tutelle de son mari pour tous les actes administratifs et judiciaires. Elle lui est inférieure en droit, et a fortiori en cas d’adultère ou de divorce. Le Code revient aussi sur l’égalité successorale imposée en 1789 et 1793, pour permettre à nouveau, dans certaines conditions, au chef de famille de privilégier un héritier et d’ainsi maintenir la continuité de l’exploitation.
Le Consulat opère progressivement la réconciliation des Français divisés par la Révolution. L’administration rassemble aussi bien des ex-Constituants, montagnards ou girondins, des thermidoriens, et même des anciens émigrés qui rentrent peu à peu au pays, et, à l’image d’autrefois, rejoignent l’armée ou les services de l’état. Tel un roi de l’Ancien Régime, Napoléon distribue places et honneurs, et renoue en cela avec une grande tradition nationale, incluant celle des courtisans qu’il n’aime guère, mais à laquelle il consent comme à un caprice bien français. Tous les talents peuvent espérer une promotion démocratique, dans l’armée ou dans l’administration et, en cela, réside la grande réussite du Consulat.
Chateaubriand décrit incomparablement le mariage entre Bonaparte et l’esprit français : « Une expérience journalière fait reconnaître que les Français vont instinctivement au pouvoir : ils n’aiment point la liberté, l’égalité seule est leur idole. Or, l’égalité et le despotisme ont des liaisons secrètes. Sous ces deux rapports, Napoléon avait sa source au cœur des Français, militairement inclinés vers la puissance, démocratiquement amoureux du niveau. Monté au trône il y fit assoir le peuple avec lui, roi prolétaire, il humilia les rois et les nobles dans ses antichambres ; il nivela les rangs, non en les abaissant, mais en les élevant : le niveau descendant aurait charmé davantage l’envie plébéienne, le niveau montant a plus flatté son orgueil[21]. »
Au niveau de l’éducation, Bonaparte prolonge les réforme du Directoire : l’enseignement devient un service unifié de l’état mais concerne essentiellement le secondaire, et les grandes écoles, pépinière des élites bourgeoises, alors que le primaire est laissé à l’initiative privée, le plus souvent cléricale. Enfin, dès 1802, il crée la célèbre distinction nationale, d’inspiration romaine, la Légion d’honneur, pour constituer un corps d’élite au service d’une nation unifiée et récompenser les actions civiles et militaires. « Si l’on distinguait les hommes en militaires ou en civils, on établirait deux Ordres tandis qu’il n’y a qu’une Nation. Si l’on ne décernait des honneurs qu’aux militaires, cette préférence serait encore pire car, alors, la Nation ne serait plus rien » déclare-t-il. Bien au-delà d’une simple distinction ou décoration, il s’agit de créer des rassemblements locaux et nationaux d’une élite distinguée par le pouvoir. Les légionnaires ont en effet le devoir de se réunir périodiquement au sein de leur cohorte. C’est une sorte de parti gouvernemental avant l’heure. La décoration est réalisée par David, et présente une étoile à cinq rayons doubles dont le centre est entouré d’une couronne de lauriers. Les grades prendront leur appellation définitive sous la Restauration.
De Marengo au Concordat, Bonaparte affirme son pouvoir personnel
C’est à Marengo, en Italie, sept mois après Brumaire, qu’il baptise sur le front militaire son nouveau pouvoir et s’impose durablement. Parti attaquer les armées autrichiennes qui assiègent Gênes, il franchit les Alpes avec son armée par le Saint-Bernard (passage immortalisé par un tableau du peintre révolutionnaire, David, qui est désormais à son service), est sauvé de peu de la déroute par Desaix (qui y laisse sa vie) et son corps d’armée. Son régime restera désormais suspendu à sa chance sur les champs de bataille. Mais il est aussi difficile de finir la guerre que la Révolution. Marengo n’a pas suffit à venir à bout de l’Autriche qui sera contrainte aux négociations par une victoire de Moreau à Hohenlinden en décembre : la paix de Lunéville, signée en février 1801, confirme en les étendant les acquis de Campo-Formio (Belgique, Luxembourg, rive gauche du Rhin), et les protectorats sur les Républiques bataves, helvétiques et italiennes. La deuxième coalition se trouve démantelée et des accords sont recherchés avec les Anglais ; le tout donne à Bonaparte une figure de continuateur de la grande nation révolutionnaire et laisse espérer un retour durable de la paix.
Sur le front intérieur, la révolte chouanne a un temps levé le pied, espérant le retour par Bonaparte d’un pouvoir royaliste, puis, déçue, elle a tenté d’assassiner celui-ci, avant de ranimer l’insurrection dans l’Ouest. Mais Bonaparte, en fin politique, n’use pas que de la répression, il entreprend de faire la paix avec l’Eglise. Il sacrifie l’Eglise constitutionnelle dont Grégoire était le chantre, et traite avec le pape « de souverain à souverain », en reconnaissant enfin à celui-ci ce que la Convention avait nié, une souveraineté territoriale. Le Concordat, durement négocié par Bonaparte, reconnait toutes les ventes des biens de l’Eglise, et la nomination, sous proposition du premier Consul, de nouveaux évêques après la liquidation de tous les anciens, constitutionnels ou réfractaires. Cette politique, pragmatique et radicale, rallie au premier Consul tous les milieux traditionnels, réactionnaires et nostalgiques, chrétiens et royalistes, mais mécontente les milieux éclairés qui regrettent la séparation de l’Eglise et de l’Etat, la mise à l’écart de la religion et des superstitions et voient dans le Concordat la fin de l’esprit républicain. Certes l’Eglise a perdu la puissance qu’elle avait sous l’Ancien régime, mais elle a retrouvé sa place auprès des consciences, car si le catholicisme n’est pas « la » religion officielle de la France, il est reconnu qu’elle est «la religion de la grande majorité des Français». Signé en 1801, le Concordat avec l’Eglise est suivi de textes qui prévoient les rapports entre les différentes religions et l’Etat (les Protestants en 1805 et les Juifs en 1808), pour un siècle, jusqu’à la loi de séparation des Eglises et de l’Etat de 1905 ! Les conflits soulevés à la Révolution entre l’Eglise et l’Etat sont loin d’être résolus, mais ils sont momentanément gelés, arrêtés.
Dans le Concordat et les textes législatifs concernant les liens entre les Eglises et l’Etat qui s’ensuivent, on a l’exemple parfait de la manière volontaire (pour ne pas dire autoritaire), radicale et pragmatique, dont Bonaparte, alias Napoléon, a géré l’héritage de la Révolution, et résolu, momentanément mais pour longtemps, les conflits qui en découlaient. Par une belle synchronicité, au moment où le Concordat prend effet, en avril 1802, sort en librairie Génie du christianisme ou beautés de la religion chrétienne du vicomte François-René de Chateaubriand, jeune écrivain de 34 ans, récemment revenu de son exil londonien, et rendu célèbre par ses œuvres Atala et René. Cette œuvre apologique, qui affirme que la liberté est plus fille du christianisme que de la Révolution, annonce le renouveau du catholicisme français au XIXe siècle et, bien entendu, le romantisme dans la littérature et dans les arts.
La dictature de salut public a dépassé toutes les espérances : en deux ans l’autorité de l’Etat fut restaurée, la France pacifiée, le budget remis en équilibre avec un franc fort, la crise économique surmontée, la guerre terminée, un nouveau droit et de nouvelles institutions furent établis. Jean Tulard[22]
Bonaparte ayant mis sur pied au niveau intérieur ses principales réformes, aurait-il du en rester là ? C’est oublier que la France est attendue sur le front extérieur où elle doit non seulement maintenir ses conquêtes mais surtout poursuivre sa mission de réformer la vieille Europe monarchique en répandant partout les idées nouvelles de la Révolution
Du Consulat à vie à l’Empire
Dès l’été 1802, pour assurer l’avenir et se garantir de l’ambition des généraux rivaux comme Bernadotte ou Moreau, il se fait élire « consul à vie », en août 1802, par trois millions et demi de Français. Il s’y ajoute le droit de désigner son successeur. « Le voilà donc, cette fois, roi de la Révolution et d’une révolution tellement ‘’terminée’’ qu’elle renonce même à l’ombre d’un système électif : ce que l’on appelle la Constitution de l’an X réserve l’éligibilité à une oligarchie d’argent[23]. »
La Révolution est terminée au-dedans, mais va-t-elle se clore au dehors, avec les Anglais et les monarchies européennes qui restent en embuscade, espérant encore et toujours ramener un Bourbon sur le trône de France ? Dès 1803 les accords avec l’Angleterre sont compromis et la guerre reprend. C’est cette situation extérieure instable qui pousse Bonaparte à aller au bout de la logique du Consulat à vie, c’est-à-dire jusqu’à l’hérédité du pouvoir, afin de consolider à jamais les acquis de la Révolution. Mais il n’est pas au bout de ses peines, alors que Joséphine ne lui donne toujours pas d’enfant, et que sa propre famille est prête à s’installer dans les ors monarchiques.
La guerre reprend en 1803 avec l’Angleterre et une nouvelle tentative d’assassinat est démasquée. En représailles il fait enlever un prince de sang royal, le Duc d’Enghien, qu’il fait juger et fusiller séance tenante, en mars 1804, dans les fossés du château de Vincennes. Il accélère le processus de création d’un Empire, sur le modèle des Carolingiens, passant pas dessus la dernière dynastie capétienne, pour rejoindre les mythes impériaux d’Alexandre, Auguste ou Charlemagne. Un sénatus-consulte du 18 mai 1804 proclame Napoléon Bonaparte « empereur des Français », un plébiscite confirme cette désignation le 6 novembre 1804 et le sacre intervient à Notre-Dame le 2 décembre de la même année.
Une cérémonie et des symboles singuliers
C’est au moment où il est le plus étranger aux rois de la vieille Europe que Bonaparte veut fonder sa domination dans leur principe. De là la bizarrerie du projet, et du sacre, par où il s’éloigne de la Révolution sans se rapprocher des rois[24].
La Constitution de l’an XII fait de Napoléon le souverain d’un empire héréditaire, de mâle en mâle, selon la loi salique qui ressurgit pour l’occasion. Néanmoins, l’empereur peut adopter un héritier, et en cas d’absence de successeur, le Sénat peut en présenter un au suffrage du peuple. Le sacre n’est pas prévu dans la Constitution mais l’idée s’impose peu à peu, pour asseoir la légitimité de l’empereur, et disqualifier définitivement Louis XVIII qui n’a pas voulu renoncer au trône de France, comme Bonaparte le lui avait demandé, mais n’a cependant pas, et pour cause, été sacré. Napoléon est agnostique et l’aspect religieux de la cérémonie ne lui importe peu, mais il en prépare minutieusement la symbolique, le choix du lieu, et n’oublie pas la postérité en commandant des tableaux au peintre Jacques-Louis David pour immortaliser les différentes cérémonies : Le Sacre et La Distribution des aigles. Pour l’occasion on fit venir le pape, Pie VII, celui-là même avec qui avait été signé le Concordat, et qui consentit finalement à se déplacer en espérant revoir certains articles de celui-ci, mais sans succès. Il était fort réservé sur la cérémonie à laquelle il ne voulait pas assister dans son intégralité, notamment au serment qui devait consacrer les principes de la Révolution. Il fut convenu que le pape ne poserait pas la couronne sur la tête de l’empereur mais qu’il la bénirait seulement. Joséphine est associée au sacre, et c’est elle qui apparaît finalement sur le tableau de David pour recevoir la couronne des mains de l’empereur. Le pape ayant appris de sa bouche qu’elle n’était pas mariée religieusement avec Napoléon, un mariage fut monté à la hâte dans la nuit précédente[25]. Las, ce mariage, pas plus que le sacre, ne sauva leur union qui resta stérile ! Napoléon fit ajouter postérieurement sa mère dans le tableau alors qu’elle était absente de la cérémonie, mais c’est Joséphine qui prête à la postérité napoléonienne son beau visage de madone, à telle enseigne qu’elle répudiée, la chance de l’empereur sembla tourner !

Toute la cérémonie fut montée au cordeau, relatée dans un procès-verbal fidèle et minutieux. Les débats, initiés au Conseil d’Etat, ont été longs avant que les deux principaux symboles, les aigles et les abeilles, soient retenus. « Crétet propose successivement l’aigle, le lion et l’éléphant. Cambacérès préfère les abeilles, puisque la France est une république avec un chef, comme une ruche ; Ségur penche pour le lion, vainqueur du léopard anglais ; Laumond pour l’éléphant, » le plus fort des animaux » ; Duroc choisit le chêne pacifique et Lebrun la fleur de lis qui, pour lui, est l’emblème de la France et non des Bourbons. Au coq finalement adopté par le Conseil d’Etat, Napoléon préfère le lion. Mais, le 21 messidor an XII (10 juillet 1804), l’Empereur raye le lion sur le décret instituant son sceau et ses armes pour imposer l’aigle. Mises au point par Denon, Gay et Biennais, les armes de l’Empire, inspirées par la Rome antique et Charlemagne, seront reprises sans grandes transformations par le Second Empire[26]. »
Sont finalement retenus : l’aigle, symbole de l’esprit, oiseau de Jupiter et de la Rome impériale, mais aussi des Carolingiens, associé aux victoires militaires, est la composante principale du nouveau blason, et sera placé au sommet de la hampe de tous les drapeaux des armées napoléoniennes ; les abeilles d’or, symbole de l’âme et donc d’immortalité et de résurrection, soi-disant reprises d’une symbolique mérovingienne (car trouvées dans le tombeau du père de Clovis, Childéric Ier), parsèment le manteau du sacre. Enfin, le collier de la Légion d’honneur, réservé à l’empereur et aux grands dignitaires, est maintenu par une chaine d’or, bordée de trophées et d’aigles, agrémentées d’abeilles et d’étoiles, alors que le motif central se compose du Monogramme de Napoléon, coiffé de la couronne impériale et retient la croix proprement dite, avec cinq branches à pointes pommelées ; la main de Justice (reconstituée) et le sceptre de Charlemagne fournissent la symbolique essentielle du pouvoir, tandis que le manteau impérial est inspiré de celui des pairs de France : de velours pourpre semé d’abeilles d’or, frangé d’or et doublé d’hermine. A l’image de celle des empereurs, la couronne est fermée et ornée d’aigles aux ailes levées alternant avec des arceaux et aboutissant à un globe crucifère. Au dernier moment, on ajoute à cette lourde série de symboles, un globe terrestre, ancien symbole du saint-Empire.
L’évènement du sacre, qui donne l’impression d’avoir été conçu pour cela, fut le serment qui lie l’Empereur aux acquis de la Révolution française et rassure l’opinion en reprenant les dispositions pacificatrices du Consulat : « Je jure de maintenir l’intégrité du territoire de la République, de respecter et de faire respecter les lois du Concordat et la liberté de cultes, de respecter et faire respecter l’égalité des droits, la liberté politique et civile, l’irrévocabilité des biens nationaux , de ne lever aucun impôt, de ne lever aucune taxe qu’en vertu de la loi, de maintenir l’institution de la légion d’honneur, de gouverner dans la seule vue de l’intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français[27]. »
Si cela nous fait encore rêver, c’est que tous les acteurs de l’épopée impériale pour une unique fois sont réunis, ce 2 décembre 1804, sous les voûtes de Notre-Dame : tous les maréchaux, de Murat à Ney, les généraux et les colonels, les grands ministres Talleyrand, Fouché, Portalis, les sénateurs, les conseillers d’Etat, les députés, les tribuns, les maires… Tout s’arrête, le temps d’une cérémonie, figé sur la toile de David. Avant c’était Brumaire, les attentats, la création des préfets, le Code civil… Dans un an, jour pour jour, ce sera Austerlitz, […][28]
Sur le champ de Mars, trois jours plus tard, se déroule la cérémonie de distribution des drapeaux portant les nouveaux symboles de l’Empire, les aigles, suivie du serment de l’armée à l’Empereur. Elle est le support du deuxième tableau de David, d’une dynamique toute romaine, comme la cérémonie elle-même, rappelant le célèbre tableau de l’artiste : Le Serment des Horaces[29]. De cette œuvre, Joséphine sera gommée a posteriori, à la demande de l’empereur, de même que, mauvais présage, les allégories de la Victoire, laissant Napoléon bien seul face à son destin qui sera jusqu’au bout décidé par les armes. Mais, restent les aigles, et leur symbole de gloire éternelle !
Du coup de Trafalgar au soleil d’Austerlitz
Le voilà donc empereur, face à deux autres empereurs, d’Autriche et de Russie, et face à ses éternels meilleurs ennemis qui sont, encore une fois, les Anglais.
Tout aurait pu réussir[30]. En octobre 1805, Napoléon installe sa Grande Armée à Boulogne, comme César lorsqu’il entreprit la conquête de l’Ile, et il tente d’entraîner la flotte anglaise dans une diversion à partir de Toulon et de Rochefort. Mais la flotte française est inférieure en nombre et en qualité à la Royal Navy. Les arsenaux avaient été négligés, les principaux officiers de marine étaient des nobles, dispersés par la Révolution, et leurs remplaçants, venus de la marine marchande, étaient de bons marins mais de piètres tacticiens, et il faut beaucoup de temps pour former des marins de qualité, capables de réagir rapidement, comme le demandait Napoléon. Par un mauvais hasard, le vice-amiral Latouche-Tréville, un des commandants en capacité de monter une telle opération, qui a déjà défait par deux fois l’amiral Nelson, meurt à Toulon avant son lancement. Villeneuve le remplace, mais n’a pas ses capacités tactiques. Par ailleurs l’Espagne entre en guerre et Napoléon tente de joindre ses forces à la flotte française, mais il surestime la flotte espagnole. Finalement la manœuvre de diversion vers les Antilles est comprise par Nelson qui revient vers l’Europe en prenant de vitesse la flotte française. De nouvelles instructions parviennent à Villeneuve de débarquer ses troupes à Naples pour mener la guerre du commerce contre les intérêts anglais. Napoléon invite l’amiral « à l’audace et à la plus grande activité ». Mais, à la tête d’une flotte franco-espagnole supérieure en nombre, celui-ci ne réussit pas à déjouer le plan de l’amiral Nelson, à la bataille de Trafalgar, au sud de l’Espagne, le 21 octobre 1805. Nelson qui a galvanisé ses hommes avec sa célèbre formule « England expects that every man will do his duty » (« L’Angleterre attend de chacun qu’il fasse son devoir »), y trouve la mort en même temps que la gloire posthume : les deux-tiers des navires franco-espagnols sont détruits, plus de trois milles hommes périssent, alors que la flotte anglaise est indemne. Cette victoire consacre la suprématie britannique sur les mers, pour plus d’un siècle, jusqu’à la Première Guerre mondiale. Napoléon abandonne son plan d’invasion de l’Angleterre, et dans tout l’Empire britannique le 21 octobre sera célébré jusqu’au début du XXe siècle, sous le nom de Trafalgar day (le jour de Trafalgar). Londres ne sera pas envahie par les troupes françaises, et aura son Trafalgar square où trône une statue de Nelson qui ressemble étrangement à Napoléon (un effet du costume, du chapeau et surtout de l’attitude, la main dans le gilet), et Paris aura sa Gare d’Austerlitz.
Avant même de devoir renoncer à son plan d’invasion de l’Angleterre, Napoléon s’est vu contraint de dégarnir, dès septembre, son camp de Boulogne d’une partie de sa Grande Armée pour répondre à la reprise des hostilités par les Autrichiens. Il répartit son armée en « sept torrents », sept corps d’armée, chacun représentant une armée en réduction, avec infanterie, cavalerie, artillerie, facile à faire manœuvrer et autonome. Ces corps d’armée sont commandés par les maréchaux Bernadotte, Marmont, Davout, Soult, Lannes, Ney et Augereau. La Garde est sous les ordres de Bessières et la cavalerie sous ceux de Murat. Dans ces corps d’armée figurent les meilleurs généraux de l’époque et cette armée nationale de 100 000 hommes, jeunes et entraînés, parfaitement organisée, est prête à répondre aux ordres tactiques de Napoléon : la rapidité et la surprise[31].

Napoléon travaille sur des cartes très précises et fait reconnaître les routes, les terrains et les forteresses avant d’y lancer ses armées. Ainsi il devance l’armée autrichienne de Mack qui n’a d’autres solutions que de s’enfermer dans Ulm puis de capituler, le 20 octobre. 30 000 hommes sont faits prisonniers portant à 60 000 leur nombre depuis le début de la guerre. « Jamais victoires ne furent plus complètes et ne coûtèrent moins » écrit-il dans une correspondance. Les forces russes de Koutouzov qui venaient à la rescousse de Mack doivent battre en retraite. Napoléon marche sur Vienne et y fait son entrée le 14 novembre. Il fait de la ville le centre de ses opérations mais la situation n’est pas bonne : l’empereur François Ier dispose encore d’une armée qui fait sa jonction avec les Russes, la Prusse menace de se joindre aux coalisés et les troupes françaises sont fatiguées. Napoléon monte alors un coup risqué. Il propose une entrevue au tsar Alexandre qui lui envoie un officier à qui il donne à voir une armée abattue, prête à battre en retraite. La suite est connue : Napoléon fait évacuer le plateau de Pratzen, près du village d’Austerlitz, dont s’emparent aussitôt les forces austro-russes, sous le commandement des deux empereurs : François Ier et Alexandre Ier. Ils dominent ainsi les Français qui se sont réfugiés en bas, et se trouvent en situation défensive inexpugnable, d’autant qu’ils sont en supériorité numérique. L’euphorie s’empare de leur camp et endort leur vigilance. Napoléon projette de les faire descendre du plateau pour les attaquer par surprise sur leur flanc. Il fait mine alors de battre en retraite et dégarnit son aile droite commandée par Davout. Dans la nuit du 1er au 2 décembre 1805, alors que le brouillard masque la réalité des mouvements des troupes, des feux surgissent dans le camp français, faisant croire à la préparation d’une retraite (alors qu’en réalité les soldats fêtaient leur empereur et l’anniversaire du couronnement), les deux empereurs, d’Autriche et de Russie, donnent l’ordre à leurs troupes de descendre du plateau pour couper la retraite des Français vers Vienne. Au matin, quand le soleil se lève, Napoléon découvre que son piège a marché, et donne le signal d’attaquer le plateau, la surprise est totale ! A 8 heures la situation est encore incertaine, mais à 10H elle est gagnée au prix d’un combat acharné : Russes et Autrichiens ont perdu 15 000 hommes et 20 000 sont faits prisonniers. Côté Français les pertes sont minimes : 1537 tués dont 109 officiers[32]. Tout reposait sur l’aile droite de Davout qui a tenu bon. Mais le pari était risqué et cette victoire, éclatante, montre l’audace de Napoléon couronnée d’une chance qui ne va pas le quitter de sitôt. Un armistice est signé avec les Autrichiens et les Russes, les 4 et 6 décembre. Le 3, Napoléon adressait à ses soldats l’une de ses plus belles et fameuses proclamations : « Soldats ! Je suis content de vous. Vous avez, à la journée d’Austerlitz, justifié de tout ce que j’attendais de votre intrépidité, vous avez décoré vos aigles d’une immortelle gloire…. Soldats, lorsque tout ce qui est nécessaire pour assurer le bonheur et la prospérité de notre patrie sera accompli, je vous ramènerai en France ; là vous serez l’objet de mes plus tendres sollicitudes. Mon peuple vous reverra avec joie et il vous suffira de dire : ‘’J’étais à la bataille d’Austerlitz’’ pour que l’on réponde : ‘’Voilà un brave’’ ».
Les conséquences d’Austerlitz sont considérables. Une nouvelle Europe nait sur son champ de bataille. Dans les six mois qui suivent, Napoléon crée quatre nouveaux souverains : les électeurs de Bavière et du Wurtemberg deviennent roi en reconnaissance de leur fidélité ; Joseph, frère ainé de l’Empereur, reçoit la couronne de Naples enlevée aux Bourbons, punis d’être entrés dans la troisième coalition ; enfin la République batave ayant été transformée en un royaume de Hollande, c’est un autre frère de Napoléon, Louis, qui en devient le souverain. La carte de l’Allemagne est remaniée : le 12 juillet 1806, Napoléon regroupe les princes de l’Allemagne du Sud dans une Confédération du Rhin dont Francfort devient la capitale et Napoléon le protecteur. Le Saint Empire romain germanique fondé par Othon, en 962, est mort. Par le traité de Presbourg, Vienne a du céder Venise au royaume d’Italie dont Milan est la capitale et Napoléon le monarque. Le même Napoléon est médiateur des cantons suisses depuis 1803. Le Grand Empire est né[33].

Un Grand Empire sous la protection d’une armée victorieuse : d’Iéna à Eylau
Cet Empire, Napoléon devra le maintenir par les armes, car ses ennemis ne renonçaient point et les Anglais ne cessaient d’entrer en scène, relançant le conflit dès qu’il risquait de s’endormir. Dès juillet 1806, ceux-ci débarquent dans le golfe près de Naples, mettent à mal les troupes de Napoléon à Maida, et la Calabre s’embrase et se révolte. « Napoléon avait disposé un peu trop librement de la couronne de Naples sans s’occuper du droit des peuples proclamés par la Révolution française. Le soulèvement de la Calabre et son cortège d’horreurs annonçaient l’Espagne et le Tyrol[34].» L’ordre fut restauré au prix d’une répression féroce, mais il fallait aussi stabiliser l’Europe du Nord.
Depuis Frédéric II, la Prusse jouissait d’un prestige certain et Napoléon a tenté un rapprochement avec le nouveau souverain, Frédéric-Guillaume III, neveu du grand Frédéric. Il incitait la Prusse à constituer une Confédération d’Allemagne du Nord, à l’image de la Confédération du Sud. Mais Frédéric-Guillaume, poussé par la reine Louise qui détestait les Français, se dérobe et signe une alliance secrète avec la Russie, puis lance un ultimatum à la France. La Prusse est prise d’une frénésie belliciste et Napoléon, surpris et contrarié, écrit à l’empereur : « Je considérerai cette guerre comme une guerre civile, tant les intérêts de nos états sont liés ». L’Europe retient son souffle. Le choc entre la Grande Armée victorieuse d’Austerlitz et l’armée formée par Frédéric II eut lieu à Iéna et à Auerstaedt. Le duc de Brunswick fut tué, la débâcle prussienne totale, l’anéantissement du pays complet et Napoléon fit une entrée triomphale à Berlin le 27 octobre 1806. Le philosophe Hegel salue en Napoléon « l’âme du monde à cheval ». Le mythe de l’invincibilité de l’armée prussienne a volé en éclat et Davout, une fois de plus, est le grand artisan de cette victoire[35].
Partout où comptait l’improvisation, la mobilité, la flexibilité, et surtout le courage, et le moral des troupes, l’armée française fut imbattable et remporta toutes les victoires pendant longtemps. « En 1806, la grande machine de l’armée prussiennes s’effondra devant une armée dont un corps entier ne tira que 1400 coups de canon[36]. » C’est Napoléon qui gagnait les batailles, ses généraux étaient démunis sans lui.
Eylau marque un tournant dans les guerres impériales : Après sa victoire sur la Prusse, Napoléon alla chercher les Russes en Pologne. L’affrontement eut lieu à Eylau, le 8 février 1807, et resta longtemps incertain, du fait d’une forte tempête de neige qui gêna les Français. Des deux côtés l’incertitude sur le succès de la journée était telle que la retraite fut ordonnée pendant la nuit. A l’écoute des Russes se retirant à l’aube, Napoléon ordonna de maintenir les positions. Le prix fut élevé. Le champ de bataille est couvert de morts et de blessés, Eylau fut une boucherie et Napoléon en fut intimement atteint et accablé.
Le blocus continental et l’espérance de Tilsit
C’est à Berlin, où il vient d’entrer après sa victoire contre les Prussiens à Iéna, que Napoléon prend, le 21 novembre 1806, une mesure destinée à asphyxier la puissance commerciale anglaise, fermant le continent européen aux navires anglais, sous le nom impropre de « blocus continental », mais dont la véritable conséquence fut bien de « bloquer le continent ». Car à vouloir imposer à toutes les puissances européennes vaincues ou alliées de fermer leurs ports aux anglais et donc de stopper tout commerce avec ceux-ci, Napoléon crée les conditions d’une crise majeure qui va peu à peu déliter les alliances, et mécontenter tous les Européens plus ou moins durement touchés par la mesure (de la simple privation de café à des crises économiques majeures comme la ruine des ports, du commerce du blé et du chanvre russes,…), et gangrénés par l’essor subit de la contrebande. Si bien que le blocus continental mine l’économie du continent et impose des sacrifices et des humiliations aux populations qui finissent par se détacher de Napoléon. Ce sont les mêmes exigences de ce fameux blocus qui entraînèrent Napoléon dans deux aventures hasardeuses, en Espagne et en Russie, pour en fermer les ports aux marchandises anglaises.

Mais pour l’heure, Napoléon vit une idylle avec l’empereur de Russie, Alexandre Ier, sur un radeau improvisé en ile, au milieu du Niémen, le 25 juin 1807. Ils sont acclamés par les soldats des deux armées, des « braves des deux extrémités du monde », comme le relate un bulletin de la Grande Armée[37]. La Russie vient d’être battue, le 14 juin 1807 à Friedland, où elle a perdu 25 000 soldats. A Tilsit, l’armistice est en train de se transformer en traité de paix, tant les deux empereurs s’apprécient. Ils esquissent un partage de l’Europe par un traité signé en secret, le 7 juillet, où Napoléon, bien que victorieux, a fait de nombreuses concessions, notamment en ce qui concerne la Pologne confiée au roi de Saxe (apparenté au tsar) sous le nom de Duché de Varsovie. Malgré tout s’esquissait une sorte de résurrection de la Pologne. Le tsar reconnaissait toutes les dispositions napoléoniennes concernant les rois de Naples et de Hollande, ainsi que la Confédération du Rhin. Il acceptait aussi la création d’un nouvel état en Allemagne, formé des anciennes provinces prussiennes à l’est de l’Elbe, le royaume de Westphalie, confié au plus jeune frère de Napoléon, Jérôme. Enfin le tsar assurait son soutien au blocus continental contre l’Angleterre et Napoléon promet son appui contre le Sultan. Les Anglais restaient alors les seuls adversaires. L’alliance très profitable à Napoléon, fut, nous le verrons, ruinée par les manigances de Talleyrand, le ministre des Affaires étrangères, plus favorable à une alliance avec les Autrichiens. Napoléon confiera en 1816 à Las Cases, à Sainte-Hélène : « J’apprends que les politiques aujourd’hui blâment fort mon traité de Tilsit ; ils ont découvert, depuis mes désastres que, par là, j’avais mis l’Europe à la merci des Russes ; mais si j’avais réussi à Moscou, et on sait à combien peu cela a tenu, ils auraient admiré sans doute alors combien j’avais mis au contraire, par ce traité, les Russes à la merci de l’Europe… Mais j’ai échoué et, partant, j’ai eu tort ; cela est de toute justice[38]. »
1809 : Wagram et l’apogée du Grand Empire
Deux ans après, l’esprit de Tilsit ne règne plus à Erfurt où se rencontrent à nouveau Alexandre et Napoléon. Ce dernier pour amener la Grande Armée en Espagne qui s’est révoltée, a besoin de s’assurer du soutien du Tsar, afin que le reste de l’Europe ne se retourne pas contre lui. Mais Alexandre, profitant de la déconvenue de la France en Espagne, poussé par ses Boyards qui souffrent du blocus continental, encouragé en sous-main par Talleyrand, préfère assurer l’Autriche de sa neutralité si celle-ci entre en conflit. L’Autriche soutenue par les finances anglaises, fomentant des troubles en Allemagne pour que la population se révolte, entre en guerre au printemps 1809. Une fois de plus, Napoléon est victorieux après avoir frôlé la défaite, grâce à la bataille décisive de Wagram, le 6 juillet. La paix de Vienne signée en octobre, enlève à l’Autriche la Galicie, confiée au Duché de Varsovie, et la coupe de la mer, en rattachant l’ensemble des provinces adriatiques qui lui restent à l’Empire napoléonien.
A la fin 1809, voilà donc la construction napoléonienne à son apogée. Jetons un coup d’œil sur la carte fantastique et provisoire de cette Europe française : une Autriche exclue d’Allemagne et coupée de la mer, une Prusse presque ramenée à ses origines et un Empire français de cent trente départements qui vont de Brest à Hambourg, d’Amsterdam à Rome et à Trieste – 750 000 km2, plus de soixante-dix millions d’habitants, dont trente sont Français. Adossés à cet Empire, les Etats satellites, disposés en arc de cercle : la Confédération du Rhin, la Suisse ‘’médiatisée’’, la république italienne, Murat à Naples, Joseph à Madrid. Enfin, avant-garde de la France vers l’est, le grand-duché de Varsovie, figure d’une Pologne renaissante mais fragile, coincée par les ambigüités de l’alliance franco-russe[39].

Cette Europe française est fragile de l’alliance incertaine avec les Russes, alors que le blocus finit par poser plus de problèmes qu’il n’en résout. Nous l’avons vu, les élites européennes du XVIIIe siècle se sont ralliées d’emblée au modèle social et idéologique né de la Révolution qui touchait toutes les zones sous gouvernance française en mettant en place l’abolition du servage, des droits seigneuriaux et de la dîme, l’égalité civile, le Code Napoléon, la liberté des cultes et des consciences, la centralisation gouvernementale. Un essor économique important du à l’amélioration des routes, à un marché européen protégé et à une conjoncture favorable a soutenu cette expansion, mais un véritable tournant s’opère après Wagram, autour de 1810, du fait de la crise économique causée par la blocus et d’une conjoncture moins favorable qui s’aggrave en 1811 : Au messianisme révolutionnaire français qui a irrigué toute l’Europe, va succéder un formidable messianisme contre-révolutionnaire nourri par le réveil de la foi catholique et la poussée de sentiments nationalistes, un peu partout en Europe. « Ce qui parvient aux peuples occupés du glorieux message de la Révolution française n’est plus l’égalité civile ou la libération sociale, mais l’oppression nationale[40].» C’est une aubaine que vont exploiter partout les rois, les seigneurs et le clergé, d’autant plus que Napoléon restant sans descendance, le destin de son empire est plus que jamais lié à sa bonne étoile sur les champs de batailles. Déjà ses proches conspirent pour son remplacement et ses frères et sœurs, abondamment dotés, pensent plus à sauver leur propre royaume que l’avenir de l’empire : son frère Louis, marié à Hortense de Beauharnais, roi de Hollande depuis 1808, laisse des ouvertures dans le blocus pour ne pas asphyxier le pays, si bien que Napoléon reprend la main sur le royaume ; Murat à Naples est pressenti pour lui succéder et il pourrait se trouver plus conciliant aux Autrichiens et aux Prussien par intérêt pour son propre royaume. Il trahira Napoléon, en 1813-1814, en rejoignant la sixième coalition, pour ces mêmes raisons. Et surtout Talleyrand, qui s’est entendu avec Fouché pour la suite à donner en cas de vacance du pouvoir, continue à travailler en sous-main avec tous ses pairs des cours européennes, pour ruiner l’alliance avec le tsar et répondre aux exigences de Vienne et de Metternich. Ce dernier, avant de devenir le ministre tout puissant à Vienne jusqu’en 1848 et le mentor du congrès de Vienne et de la politique européenne du XIXe siècle après les guerres napoléoniennes, a été ambassadeur à Paris de 1906 à 1809, après l’avoir été à Berlin et à Saint-Pétersbourg. Il a frayé avec Talleyrand, tout en étant l’amant de Caroline Murat (la propre sœur de l’empereur). Lorsqu’en 1810, l’empereur s’émeut des manigances de ses proches et tance Talleyrand en lui enlevant ses fonctions de chambellan, mais sans sévir outre mesure, ce dernier vend chèrement ses services à la cour d’Autriche, grâce à Metternich qui sert d’intermédiaire[41]. Le même Metternich qui souffle à la cour de Vienne l’intérêt d’un mariage de Marie-Louise avec l’empereur, pour adoucir les suites de Wagram, et alors que Napoléon tente d’obtenir la main de la sœur du tsar.

Le mariage autrichien pour asseoir une descendance monarchique
C’est dans cette atmosphère que Napoléon, sans doute manipulé par ses proches, après avoir à contre cœur divorcé de Joséphine, finit par renoncer au mariage russe (la réponde du tsar se faisant attendre), pour acquiescer au mariage avec l’archiduchesse Marie-Louise qui se plie à la volonté de son père et aux intérêts de la monarchie. Choix funeste ? Les Français regrettent Joséphine et ne voient pas d’un bon œil l’arrivée d’une autre autrichienne, la nièce même de Marie-Antoinette, quelque peu terrorisée de se retrouver dans ce pays régicide qui a tué sa tante. Un temps l’empereur a pensé adopter son neveu (le fils ainé de son frère Louis et de la fille même de Joséphine, Hortense) mais celui-ci étant décédé, il a recherché d’autres solutions avec l’aide de tous ses conseils et organes consultatifs. Un temps il a même pensé s’unir à une demoiselle de la Légion d’Honneur : cela aurait eu du panache et sans doute plus enthousiasmé les Français qu’un mariage à l’ancienne avec une descendante d’une vieille monarchie que la France ne cessait de combattre. Mais poussé par ses proches, et espérant sans doute mettre fin aux conflits avec l’Autriche en bénéficiant de la protection de son beau-père, il se résout au mariage avec Marie-Louise. On connait la suite : Ils eurent une union plutôt heureuse malgré les circonstances, qui leur donne rapidement, dès 1811, l’héritier tant attendu, un fils, le roi de Rome ! Mais sans doute trop tard : l’enfant est chétif, la mère irrésolue, bien que fidèle et dévouée à Napoléon tant qu’il se maintient au pouvoir, et ce mariage ne garantit nullement le soutien de l’Autriche, puisque celle-ci entrera finalement dans la sixième coalition de toutes les puissances européennes contre la France, en 1812-1814.
La chance l’a abandonné, semble-t-il, lorsqu’il a répudié celle qu’il aimait et avait lui-même couronnée Impératrice, Joséphine. Sa nouvelle épouse est l’otage de la cour de Vienne et des alliances européennes et, d’impératrice des Français pendant trois ans, elle deviendra simple duchesse de Parme. Leur fils, cruelle destiné, élevé comme un archiduc d’Autriche (Napoléon avouait qu’il aurait préféré le voir mort qu’élevé à la Cour de Vienne), sous le nom de Duc de Reichstadt, sans doute sincèrement aimé par son grand-père François Ier, mais peu défendu dans son double héritage, ni par sa mère, ni par l’entourage de Napoléon, n’aura aucune place dans le partage de l’Europe par le congrès de Vienne en 1815. Il mourra tristement de phtisie en pleine jeunesse, à 21 ans, en 1832, au château de Schönbrunn, dans la pièce même ou logeait son père lorsqu’il occupait Vienne, du temps des victoires d’Austerlitz, d’Iéna ou Wagram, et en présence de sa mère qui avait fondé une nouvelle famille. Il fut reconnu empereur de manière éphémère par les Assemblées françaises, sous le nom de Napoléon II, après les deux abdications de son père en 1814, puis en 1815, mais la postérité a retenu le surnom d’Aiglon, de la fameuse pièce d’Edmond Rostand, jouée en 1900 par Sarah Bernhardt dans le rôle titre. Ses armes, comportant deux lions à tête d’aigle, restent dans la lignée impériale de son père. L’Empire ressuscitera en 1852, avec Louis-Napoléon, troisième fils de Louis et d’Hortense de Beauharnais. Ainsi la postérité napoléonienne reste dans la lignée du premier couple impérial : Napoléon et Joséphine.
Il semble évident que toute une oligarchie diplomatique (comprenant Talleyrand et Metternich), liée aux anciennes monarchies européennes, avait préparé de longue date le partage de l’Europe postnapoléonienne dans le sens de leurs intérêts. Ainsi, en 1815, alors que le tsar Alexandre Ier aurait accepté de placer le roi de suède, Bernadotte (encore un destin exceptionnel, né de la Révolution, ancien maréchal d’empire, époux de la première fiancée de Napoléon, Désirée Clary, élu monarque par la Suède, ayant rejoint la sixième coalition) à la tête de la France après l’abdication de Napoléon, le clan pro-autrichien réussit à remettre les Bourbons en selle. On comprend la litanie angoissée de Madame Mère, Letizia Bonaparte : « Pourvu que ça dure !» Les ennemis étaient partout, au sein même de sa propre famille, et parmi ceux qui lui devaient leur place et la gloire.
La campagne de Russie et la fin de l’Empire
Dans ce contexte mouvant, où toutes les monarchies européennes, y compris les Anglais, restaient en embuscade et ses proches se dérobaient, Napoléon n’avait que les armes victorieuses pour maintenir son empire. C’est pour tenter de forcer une nouvelle alliance avec le tsar Alexandre Ier qu’en juin 1812, il franchit le Niémen avec sa Grande Armée, forte de 610 000 hommes (comportant toutes les nationalités du vaste Empire, dont environ 400 000 Français) pour se diriger vers Moscou. Il s’enfonce dans les mornes plaines slaves à la recherche de l’armée russe qui, comme le tsar, se dérobe et l’entraîne toujours plus loin, non pas tant par tactique, que par impossibilité de s’opposer à cette énorme machine de guerre napoléonienne, supérieure en nombre et en tactique. Certains historiens pensent que si Napoléon avait poussé son armée vers la nouvelle capitale, Saint-Pétersbourg, au lieu de l’ancienne, Moscou, il aurait eu forcément l’avantage[42]. Le 7 septembre, la grande victoire de Borodino contre les Russes, surnommée par les Français bataille de la Moskova, ouvre à l’Empereur les portes de Moscou abandonnée par la majorité de ses habitants et vidée de tout ravitaillement. Le commandement russe ne se rend pas, mais Napoléon accorde un armistice, et propose des négociations de paix à Alexandre qui reste évasif, faisant perdre un temps précieux à Napoléon. Entre temps la ville est en flammes et presque entièrement détruite. N’ayant le choix qu’entre deux solutions aussi désastreuses l’une que l’autre, rester à Moscou pour l’hiver, attendant le bon vouloir du tsar, sans aucune perspective de ravitaillement suffisant, ou battre en retraite alors que l’hiver est déjà engagé et que les zones à traverser n’ont pas la capacité de nourrir et d’abriter une si grande armée, Napoléon choisit de quitter Moscou le 18 octobre. Il remarquera plus tard que s’il avait engagé le combat quinze jours seulement avant de quitter Moscou, contre l’armée russe qui campait à portée de la ville, il aurait été victorieux. Il entame avec son armée la retraite qui sera tout entière résumée, dans la mémoire collective française, par la célèbre traversée de la Bérézina. On continue ainsi d’ignorer que la bataille de la Bérézina fut une victoire française, fin novembre 1812, qui évita justement un (plus grand) désastre avant que les troupes ne traversent l’immense rivière. Mais ce fut une bataille victorieuse de plus dans une campagne néanmoins perdue qui se solde par une retraite sans qu’aucun accord n’ait été obtenu. La retraite de Russie fut, pour les soldats de cette immense armée, une épreuve majeure, où la plupart ont fait preuve d’un courage surhumain, mais où beaucoup périrent. L’armée sut gagner les batailles tant qu’elle put vivre sur les pays occupés. Mais lorsqu’elle se trouva dans les espaces moins riches et désolés de Pologne et de Russie, en proie au froid et à l’absence de ravitaillement, elle perdit ses forces. L’absence totale de secours sanitaires multiplia les pertes. Entre 1800 et 1815, Napoléon perdit 40% de ses forces (dont 1/3 par désertion), « mais 90 à 98% de ces pertes concernent des hommes qui moururent non pas au combat, mais de blessure, de maladies, d’épuisement et de froid. En somme ce fut une armée qui conquit l’Europe par une série de coups brefs et violents, non seulement parce qu’elle le pouvait, mais parce qu’elle ne pouvait faire autrement[43]. » La Russie lui fut fatale !

Cet affrontement de titans entre la puissante et invincible Grande Armée napoléonienne et une armée russe renaissant sans cesse de ses cendres, puisant ses forces dans l’immensité de son pays glacé tellement inhospitalier à qui lui est étranger, est entré dans la légende des deux pays, notamment grâce au grand romancier russe Tolstoï qui en fait le théâtre de son Guerre et Paix.
Napoléon laisse le commandement de sa Grande Armée à Murat, qui lui-même le laissera à Eugène de Beauharnais, pour rejoindre en hâte son royaume de Naples. Du 7 au 18 décembre 1812, accompagné de cinq hommes seulement dont le général, aide de camp et diplomate Caulaincourt, Napoléon traverse en hâte et incognito l’Europe en traineau puis en berline pour rejoindre Paris où la tentative de coup d’état du général Malet a échoué. Les Etats européens voient venir l’heure d’une revanche longtemps attendue, des insurrections éclatent un peu partout, dans les territoires allemands sous protectorat français, en Italie et en Espagne, où les troupes anglo-espagnoles chassent Joseph de Madrid et s’avancent vers les Pyrénées. La Prusse s’allie avec la Russie et déclare la guerre à la France, l’Autriche propose une médiation aux conditions inconcevables pour la France, et Napoléon passe l’hiver à lever des troupes. En France même, l’humeur a changé, le pays est fatigué de la guerre ; notables et nantis souhaitent terminer l’aventure, même si cela est au prix de la restauration de la royauté. Napoléon ne peut plus régner, en France comme en Europe, sans une nouvelle victoire. C’est chose faite, à Lutzen et à Bautzen, en mai 2013, contre les Russo-Prussiens. Et pourtant, les négociations de paix échouent, car les puissances européennes, bien décidées à se débarrasser définitivement de Napoléon, ne font que gagner du temps en soumettant des conditions logiquement inacceptables pour un vainqueur : elles proposent à la France de revenir aux anciennes frontières de Lunéville (1802), alors que Napoléon campe sur les frontières de 1812. Mais en août, l’Autriche et la Suède de Bernadotte se joignent à la sixième coalition qui, forte des subsides anglais, compte alors plus d’un million de soldats. Napoléon ne peut plus négocier et tout va se jouer, une fois de plus, à quitte ou double, sur le champ de bataille. Il est défait à Leipzig, et les troupes coalisées convergent vers la France et s’y enfoncent pour la ramener aux frontières de 1792. Napoléon brille de ses derniers feux lors d’une campagne de France éblouissante autour de Paris où il se joue de trois armées, mais cela ne fait que retarder l’échéance. Paris abandonnée par Marie-Louise et les notables, capitule le 30 mars, Napoléon, se résigne à capituler le 6 avril et rejoint l’ile d’Elbe où il est assigné à résidence par les alliés. Ceux-ci investissent Paris, et le tsar de Russie – marque cruel le du revers de destin pour Napoléon – est reçu par Joséphine et Hortense à la Malmaison.
Les guerres impériales et les bouleversements en Europe : vers les révolutions sociales du XIXe siècle
Il est de bon ton, dans l’opinion commune, de critiquer les guerres napoléoniennes et de dénoncer, c’est le cas de le dire, l’impérialisme à l’œuvre et l’esprit guerrier de conquête et de domination, comme si Napoléon avait voulu et suscité lui-même toutes ces guerres. Il est entré dans l’armée comme simple soldat de la Révolution, et il sait donc d’où il vient. Il sait combien la patrie et la République et tous les acquis de la Révolution étaient en péril. Et il a inlassablement tenté d’opérer des alliances pour trouver un équilibre européen capable de faire cesser les guerres. Mais les puissances concernées n’en ont pas voulu, se coalisant par six fois pour venir à bout de la France, une France contrainte à être offensive, et victorieuse pour mettre en place des accords de paix temporaires, sans cesse remis en question par l’un ou l’autre des coalisé, comme s’ils prenaient le relais. Lorsque ce ne furent pas seulement les vieilles monarchies mais les peuples qui se soulevèrent, comme en Espagne, en Italie puis de manière plus sporadique en Allemagne et en Russie, la France se retrouvait face au même phénomène qu’en Vendée : des paysans se coalisant avec leurs anciens maîtres, de la noblesse ou du clergé, avec qui ils partagent une identité de nature religieuse, idéologique, ou territoriale, parfois nationale, plus forte ou plus rassurante que celle que proposent les nouveaux venus, même s’ils promettent l’abolition des vieux droits féodaux et l’avènement de la liberté et de l’égalité. Celles-ci restent inconcevables par des consciences encore ensevelies et bercées par des fonctionnements d’un autre âge.
Cette paix, Napoléon l’a tentée avec la Prusse, puis par deux fois avec la Russie, enfin avec l’Autriche par différents moyens, dont son mariage avec Marie-Louise, la fille de l’empereur François Ier. Avec les Anglais, les choses étaient claires d’emblée : ils n’ont jamais souhaité un accord de paix et Napoléon n’avait d’autre choix que de mettre en place une politique pour freiner leur expansion économique, par différentes opérations comme en Egypte, puis par le blocus continental, la solution militaire d’invasion de l’Ile ayant échoué. D’une manière ou d’une autre, ce sont les Anglais qui ont toujours ruiné les efforts de Napoléon dans le sens d’un accord de paix, finançant les puissances européennes pour qu’elles poursuivent la guerre, conduisant des opérations de soutien aux insurgés comme en Vendée, à Toulon et dans le Sud de la France, du temps de la Révolution, puis ensuite en Italie, en Espagne… ou rejoignant même carrément la coalition européenne, comme en 1814-1816 et lors des Cent-Jours. Ce n’est pas par hasard que les Anglais ont finalement décidé du destin de Napoléon après sa deuxième capitulation.
Dans tous les territoires conquis par l’armée impériale (sauf dans le grand duché de Varsovie), les institutions napoléoniennes nées de la Révolution française furent automatiquement appliquées, ou servirent de modèle à l’administration locale : Comme nous l’avons vu, le féodalisme était officiellement aboli, le Code civil français adopté et «ces novations se révélèrent beaucoup moins réversibles que les modifications de frontières. Ainsi le Code civil de Napoléon demeura ou redevint le fondement du droit local en Belgique, en Rhénanie (même après son retour à la Prusse) et en Italie. Le féodalisme, une fois officiellement aboli, ne fut nulle part rétabli[44] ». « Bref, on peut dire, en exagérant à peine, qu’aucun Etat continental important, à l’ouest de la Russie et de la Turquie, et au sud de la Scandinavie (excepté peut-être les Etats pontificaux) n’est sorti de ces vingt années de guerre avec des institutions intérieures vraiment intactes, que l’altération soit le fait de l’expansion, ou de l’imitation de la Révolution française. Même l’ultraréactionnaire royaume de Naples n’a pas rétabli réellement un féodalisme légal, après son abolition par les Français[45]. »
Ces vingt années de guerre européennes transformèrent aussi profondément l’atmosphère politique. Partout les anciennes monarchies ont été remises en question et cela marquera toute la politique européenne du XIXe siècle après la disparition de l’empire napoléonien en 1815 : on savait désormais qu’une révolution dans un seul des pays européens pouvait se propager dans tout le continent et balayer les systèmes politiques, « on savait désormais que la révolution sociale était possible ; que les nations existaient comme quelque chose d’indépendant des Etats, les peuples comme quelque chose d’indépendant du gouvernement, et même les pauvres comme quelque chose d’indépendant des classes dirigeantes [46]». La Révolution française était non seulement un évènement exceptionnel mais universel et aucun pays n’était immunisé contre elle.
Les soldats français qui ont fait campagne depuis l’Andalousie jusqu’à Moscou, depuis la Baltique jusqu’à la Syrie – sur une étendue plus vaste qu’aucune troupe de conquérants depuis les Mongols, plus vaste à coup sûr qu’aucune force militaire avant eux en Europe, sauf les Normands – ont étendu l’universalité de leur révolution intérieure plus efficacement que ne l’aurait fait n’importe quel autre agent. Et les doctrines et les institutions qu’ils ont transportées avec eux, même du temps de Napoléon, depuis l’Espagne jusqu’à l’Illyrie, procédaient de doctrines universelles, comme les gouvernements l’apprirent et comme les peuples eurent tôt fait de l’apprendre aussi. Un Grec, à la fois brigand et patriote, a parfaitement exprimé ces sentiments : ‘’Selon moi, dit Kolokotrones, la Révolution française et les exploits de Napoléon ont ouverts les yeux au monde. Les nations ne savaient rien jusque-là et les peuples pensaient que les rois étaient des dieux sur terre et que, quoi qu’ils fissent, il fallait dire que tout était bien fait. Avec ces changements d’aujourd’hui il est plus difficile de gouverner les peuples[47]. ‘’
Par ailleurs, comme le souligne justement Eric J. Hobsbawm[48], à part les morts sur les champs de bataille, qui s’élèvent côté français à un demi-million d’hommes (et sans doute moins d’un million au total), les guerres de la France révolutionnaire puis napoléonienne avec l’Europe n’ont pas été des guerres barbares comme l’ont été, au XVIIe siècle, les guerres de religion (la guerre de Trente Ans avait fait 3 à 4 millions de morts), ou comme le furent les guerres du XXe siècle. Les pays n’ont pas été ravagés, pas même dans la péninsule ibérique où les opérations militaires furent plus longues que partout ailleurs et surtout plus sauvages, du fait de la résistance populaire. Les pertes humaines provoquées par ces vingt années de guerre ne sont pas très élevées, en comparaison de celles de notre époque (65 millions de mort lors de le Deuxième Guerre mondiale dont 20 millions en Union soviétique). Et, comme nous l’avons déjà évoqué, la plupart des morts ne sont pas tombés au combat mais ont succombé au manque de soins et d’hygiène. Pour la plupart des habitants de l’Europe qui n’étaient pas des combattants, ces guerres n’ont guère entamé la vie normale, elles l’ont tout juste interrompu pendant quelque temps pour ceux qui étaient proches des lieux de conflit. En revanche, les exigences économiques de la guerre et la guerre économique lancée par le blocus continental en particulier, eurent des conséquences plus importantes et plus graves.
Destin individuel, national et international de Napoléon
Au niveau individuel, le destin de Napoléon est absolument exceptionnel et sans précédent durant l’histoire, et pas seulement l’histoire de France. A lui seul il couronne la Révolution française dont il est le fils le plus glorieux. Petit caporal devenu empereur grâce à ses seuls mérites militaires, disposant d’une intelligence véloce et hors du commun pour les affaires civiles aussi bien que militaire, il est à la fois le fils de la révolution et le père protecteur de la nation, en tant que chef d’une Grande Armée issue de la conscription. Mais il était condamné à renouveler en permanence des victoires, sans aucun moyen d’arrêter la guerre, comme ses prédécesseurs n’ont pas pu et pas su arrêter la Révolution.
Au niveau intérieur le destin de Napoléon était assurément de fixer les acquis de la Révolution, (il s’est dit républicain même en étant empereur et cela jusqu’en 1809), de pacifier le pays après les déchirements de la chaude période révolutionnaire en organisant une paix religieuse et une structure légale et administrative dont le fonctionnement a traversé tous les régimes ultérieurs et perdure jusqu’à nos jours. Son rôle était aussi de poursuivre ce pourquoi il avait été appelé au pouvoir : la défense victorieuse sur le théâtre européen des intérêts français constamment menacés par ses ennemis de l’extérieur.
Au niveau européen et international, il semble que le destin de Napoléon était de propager les nouvelles idées issues de la Révolution en Europe et de donner les premiers coups de boutoir aux vieilles monarchies européennes qui ne se sont pas effondrées sur le moment mais qui ont définitivement, bien qu’à long terme, à l’échelle d’un siècle, perdu la partie. L’Angleterre quand à elle a réussi à rester maître des mers et par là de la liberté de commercer tout en faisant prospérer ses colonies et son immense empire en construction.
On a retenu la terrible épreuve de la Bérézina comme épithète de catastrophe grandiose et de repli tragique, car la retraite de Russie sonne l’heure du reflux de l’immense épopée napoléonienne qui va devoir se replier jusqu’à ses sources, la France de 1792, après avoir semé partout en Europe, les idées et les acquis de la grande Révolution. Napoléon a fini son œuvre, il a accompli le destin pour lequel il s’est trouvé hissé au sommet, et sa fin sera tragique et injuste, abandonné et trahi par tous ceux qu’il avait aimé et élevé, comme chaque fois que le destin des nations a épuisé le génie militaire, civil ou spirituel de l’un des siens.
Mais, comme on l’a vu, et c’est sans doute le grand enseignement de l’histoire, de la diffusion des idées et de l’évolution des consciences : les hommes croient bâtir des empires terrestres, alors qu’en réalité ils ne font que semer des idées, et diffuser ce dont ils sont porteurs ! C’était vrai pour l’empire d’Alexandre qui a porté haut et loin les valeurs de la Grèce antique tout en recevant de l’Orient et l’Egypte ce qu’il y avait de meilleur, ce le fut pour l’empire romain qui a essaimé partout en Europe le droit, les institutions et la langue, pour ne pas dire une religion qu’il avait lui-même combattu, le christianisme. Ce ne sont pas les victoires militaires qui sont déterminantes : elles ne sont que temporaires. Les idées perdurent après la mort des hommes et des empires lorsqu’elles sont encore fertiles. Et celles de la Révolution française n’ont toujours pas fini de donner leurs fruits.

C’est pourquoi les hommes et les peuples aiment les grands conquérants : ils savent inconsciemment qu’au-delà des gloires éphémères des empires qu’ils bâtissent, ils ont contribué à semer une nouvelle conscience. Ce travail de la conscience ne passe pas par les victoires militaires, la force ou la contrainte, comme celle de l’Inquisition, il traverse le temps à travers les hommes qui, selon leur propre conscience, cultivent les idées qui les inspirent parmi celles que les grands conquérants ont semé sur leur passage.
Conclusion : rôle et postérité de Napoléon
En tant que général, il n’eut pas d’équivalent, en tant qu’homme d’Etat, ce fut un planificateur et un organisateur, qui savait superviser le travail de ses subordonnés, et qui a su stabiliser tous les grands acquis de la Révolution et les inscrire durablement.
Le peuple était fascine par l’image unique d’un homme du peuple devenu plus grand que ceux qui naissaient avec une couronne sur la tête, mais il fut plus que cela encore, cet homme éclairé du XVIIIe siècle, issu de la Révolution, héritier de ses valeurs, qui sut faire rayonner son pays à l’extérieur, jusqu’à réaliser un empire européen, en triomphant de presque tous ces ennemis.
Pour la plupart de ses idées il avait été devancé par la Révolution et le Directoire, mais il sut les mettre en pratique et les faire fructifier : la jurisprudence française, les codes, le système hiérarchisé de fonctionnaires, depuis les préfets jusqu’au bas de l’échelle, toutes les carrières de la vie publique française, de l’armée à l’éducation, conservent la marque napoléonienne d’un pouvoir central, autoritaire et hiérarchisé. Mais surtout, au moment, il a su apporter la stabilité et la prospérité à la France (contrairement à l’Angleterre, son ennemie, qui s’est dans le même temps considérablement appauvrie), si ce n’est aux quelques quart de millions d’hommes qui ne revinrent pas de ses guerres… mais qui apportèrent quand même la gloire à leurs familles comme le note Hobsbawm !
La persistance du bonapartisme, comme idéologie, parmi les Français qui ne s’occupaient pas de politique, comme par exemple chez les paysans riches, a rendu possible le retour d’un second Empire : Avec un Napoléon plus petit que l’autre !
Napoléon n’avait détruit qu’une seule chose : la révolution jacobine, ce rêve d’égalité, de liberté et de fraternité, le rêve du peuple se dressant dans sa majesté pour détruire l’oppression. Et ce mythe était plus puissant encore que le sien, puisque après sa chute, c’est lui et non le souvenir de l’Empereur, qui inspira les révolutions du XIXe siècle, dans son propre pays[49].
Analyse astrologique
Vingt ans d’épopée napoléonienne, c’est le temps d’une génération, et en astrologie le temps d’un cycle Saturne-Jupiter d’intégration d’une nouvelle conscience.
Napoléon est né un jour peu ordinaire, le 15 août, si bien que lors de l’Empire et dans la suite de la déchristianisation révolutionnaire et des célébrations calendaires nouvelles, cette journée fêtait son anniversaire plutôt que l’Assomption de la Vierge, la Vierge par ailleurs protectrice de la France depuis Louis XIII.
Son Soleil est en Lion, signe solaire d’épanouissement, de rayonnement et de gloire, le signe même de la personnalité de la France. C’est pourquoi il a tant plus aux Français lorsqu’il a porté loin le rayonnement et la gloire du pays. En un seul homme les étapes de métamorphose du Lion se sont vécues durant les vingt ans d’accomplissement de sa destinée étroitement imbriquée à celle de la France : Du Lion qui dort de sa jeunesse, au Lion qui lève la tête lors du siège de Toulon, puis s’assoit lors de la campagne d’Italie, et se met debout pour marcher d’un pas ferme et décidé, lors de l’expédition égyptienne ; il rugit lors du coup d’état de Brumaire, pour devenir premier Consul puis Consul à vie ; puis le Lion rampe quelque temps pour se maîtriser et donner à la France tous les fondements d’une bonne gouvernance future : enfin, le Lion couronné lors du sacre et le Lion ailé (métaphoriquement représenté par l’Aigle ou les abeilles, emblèmes du sacre) qui parcourt victorieux l’Europe et se fait saluer par le soleil des batailles triomphales d’Austerlitz, Iéna, Eylau, Wagram… Mais comme il ne s’agit que d’un empire terrestre, la métaphore ne tient pas pour la France dans le temps, et au-delà de l’épopée napoléonienne. La France a pu s’identifier pleinement dans cette aventure napoléonienne, cependant il eût fallu une victoire définitive (Il faudra se demander si une victoire peut-être un jour définitive … Nous le ferons en abordant le traité de Versailles de 1918, lourd de conséquences), sans le reflux de la campagne de Russie.
Au niveau terrestre et donc de la personnalité de la nation (le territoire, le régime et les institutions), ce ne fut qu’un feu de paille, comme les feux fêtant l’anniversaire du couronnement de l’empereur, lors de la veillée d’armes d’Austerlitz, mais quels feux ! Quel couronnement d’une personnalité à ce point identifiée à celle de la France ! Car il ne s’agit pas du soleil de Louis XIV d’élection divine, qui a saupoudré la France du haut vers le bas, à l’aube du siècle des Lumières, mais du soleil érigé par tout un peuple et qu’un fils du peuple a pu émaner au nom d’une nation entière. L’élection de Napoléon n’est pas divine : il s’est fait tout seul, par l’exercice de son propre génie militaire et civil, avant d’assurer un mariage réussi et fécond avec tout un peuple (le couronnement où le pape n’était qu’un témoin, et où le serment était central, célébrait finalement ses épousailles avec la nation… Joséphine représentait au niveau allégorique cette même nation qu’il avait épousée et qu’il couronnait). Il fit rayonner les valeurs de ce peuple pendant vingt ans sur tout le théâtre européen avec sa Grande Armée, véritable émanation de la nation puis de tous les peuples de l’empire. A-t-il compris et accepté intimement cette mission lors de sa nuit dans la grande pyramide ? L’épopée de Napoléon ressemble à celle d’un missionné, d’un être qui se sent investi par tout un peuple et par l’âme de la France, d’une mission civilisatrice qui le dépasse et dépasse les autres nations. Mais j’entends déjà s’élever les voix de ceux qui se méfient, non sans raison, des missions et des missionnés… Car on ne peut faire le bonheur des peuples malgré eux ! Toute mission, comme tout destin individuel ou collectif, ne s’accomplit que dans la plus grande solitude et la plus grande discrétion et il y a lieu de se méfier de tous ceux qui prétendent porter le destin d’un groupe, d’un peuple ou du monde. Napoléon ne s’est jamais prévalu d’aucune mission… Il n’a jamais prétendu à quoi que ce soit, et dans la solitude de son exil à Saint Hélène, il continuait à chercher à comprendre le sens et les méandres de sa destinée aussi exceptionnelle.
A travers Napoléon, la nation a accompli sa destinée et a mis sa personnalité (sa Grande Armée, le peuple, ses élites politiques, administratives et scientifiques) au service d’un dessein intérieur et extérieur assez clair : fixer ce qui pouvait l’être des acquis de la Révolution française, essaimer les nouvelles idées en Europe et au-delà. Et pour cela elle a avancé courageusement tel un lion rampant avec le collier de la maîtrise autour du cou… Mais le travail n’est qu’en partie accompli, il est même juste commencé. L’âme Poissons de la France va devoir encore et encore se mettre au service de l’humanité, avec compassion et sans gloire superfétatoire, partout où celle-ci en aura besoin et ne sera pas respectée dans ses droits, selon les valeurs révélées par la Révolution française…. Les chantiers sont nombreux et vont surgir lors des convulsions révolutionnaires du XIXe siècle, entre des périodes stables mais régressives de restauration de l’Ancien régime et même d’un second Empire.
Le bonapartisme, correspond bien à la fierté française primaire, à la personnalité orgueilleuse du pays. Lors des régimes futurs des XIXe et XXe siècles, la France va rester dans le dualisme Poissons, ballotée entre gauche et droite, entre des régimes progressistes et conservateurs, à la recherche d’institutions introuvables capables d’assurer son rayonnement intérieur et extérieur et de répondre à sa mission. Dans l’esprit français, il y aura toujours la nostalgie d’un nouveau Bonaparte capable de transcender tous les problèmes et de résoudre tous les antagonismes. La France ne retrouvera qu’en De Gaulle un être d’une telle envergure, capable d’assumer une mission centrale.
Au niveau des cartes du Ciel
Voici les deux cartes du Ciel de la Première République et de Napoléon.


Il est intéressant de constater que l’Ascendant de Napoléon est au début du Scorpion, comme celui de la Première République française, où se trouve par ailleurs Jupiter. Ainsi Napoléon, par son Ascendant (qui détermine son projet de Vie) incarnait merveilleusement le Jupiter (l’expansion, la gloire, la chance, le chef) de la Révolution française. Le Scorpion a pour emblème supérieur l’aigle, choisi dans les armes de l’Empire. Par ailleurs, le Soleil Lion de Napoléon se trouve au degré même de l’Uranus de cette première République, qui va donc rencontrer en Napoléon son expression individuelle la plus solaire.
Notons dans la carte de Napoléon un remarquable grand trigone de Terre entre les trois planètes transpersonnelles qui augure un accomplissement.
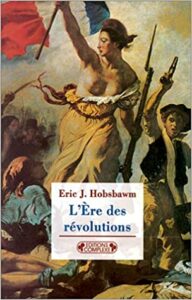
[1] Selon l’expression d’Eric J. Hobsbawm, dans L’ère des Révolutions, 1789-1845, Pluriel. Tome 1 de sa trilogie : Le long XIXe siècle. Respectivement ., p. 98.
[2] Ibid., p. 107.
[3] Wikipédia, Napoléon, biographie.
[4] Jean-Marie Rouart, Napoléon ou la Destinée, Gallimard, 2012.
[5] Ibid., p 38.
[6] Ibid., p 50.
[7] Reconnaissant envers tous ceux qui ont accompagné son destin et lui sont restés fidèles ou se sont sacrifiés pour lui, depuis l’Ile d’Elbe, plus de vingt ans plus tard, Napoléon n’oubliera pas la veuve de Muiron et leur enfant dans son testament.
[8] François Furet, op. cit., p. 426 et 427.
[9] Ibid., p. 427.
[10] Ibid., p. 428.
[11] Ibid., p. 429.
[12] François Furet, op. cit., p. 437.
[13] Ibid., p. 443.
[14] Ancien député des Landes à la Convention, ancien Directeur et membre du Conseil des Anciens, ami de Sieyès. Il a voté la mort du roi et devra s’exiler à la Restauration.
[15] François Furet, op. cit., p. 450.
[16] Eric J. Hobsbawm, op. cit., p. 100.
[17] François Furet, op. cit., p. 452.
[18] Ibid., p. 455.
[19] Ibid., p. 455, citant le discours de Napoléon au Conseil d’Etat, le 4 mai 1802, recueilli dans les Mémoires sur le Consulat de Thibaudeau, p. 79.
[20] Ibid., p. 459.
[21] Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, XXIV, 6.
[22] Jean Tulard, Napoléon, les grands moments d’un destin, Fayard, 2006, p. 247.
[23] François Furet, op. cit., p. 474.
[24] Ibid., p. 477.
[25] Jean Tulard, op. cit., p. 253.
[26] http://www.napoleon.org/fr/essentiels/symbolique/
[27] Jean Tulard, op.cit., p. 254, citant le procès-verbal de la cérémonie (page 58). Notons qu’en En 1810, Napoléon ne se déclarera plus « par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, Empereur des français », mais « par la grâce de Dieu et les constitutions, Empereur des français ».
[28] Ibid., p. 255.
[29] Les tableaux de David sont pour la plupart exposés au Louvre, ou se retrouvent parfois en double à la salle du sacre, au château de Versailles.
[30] Jean Tulard, op. cit. p. 256 à 263, chap. 21 : Trafalgar, l’Angleterre est désormais invincible, pour tout ce qui suit.
[31] Ibid., p. 264 à 274, chap. 22 : 2 décembre 1805, Le pari risqué d’Austerlitz
[32] Ibid., p. 272.
[33] Ibid., p. 274.
[34] Ibid., p. 284.
[35] Ibid., p; 292.
[36] Eric J. Hobsbawm, op. cit., p. 98.
[37] Jean Tulard, op. cit., p. 310.
[38] Ibid., p. 317, citant M. Dunan dans son ouvrage, Le radeau de Tilsit, p. 139.
[39] François Furet, op. cit. Chap. V, Napoléon Bonaparte, p. 497
[40] Ibid., p. 499.
[41] Jean Tulard, op. cit., p. 373, chap. 33 : Le rapprochement Talleyrand-Fouché.
[42] Jean Tulard, op. cit., p. 453 et suivantes, chap. 40 : Pourquoi Napoléon n’a-t-il pas pris Saint-Pétersbourg en 1818.
[43] Eric J. Hobsbawm, op. cit., p. 99.
[44] Eric J. Hobsbawm, op. cit. p. 119.
[45] Ibid., p. 120.
[46] Ibid., p. 121.
[47] Ibid., p. 121.
[48] Ibid., p. 123 et suivantes.
[49] Eric J. Hobsbawm, op. cit., p. 102.

Le 18/12/2020
